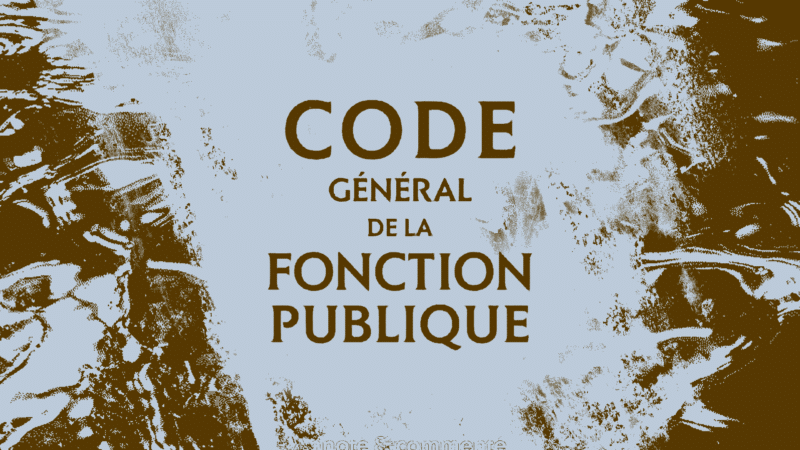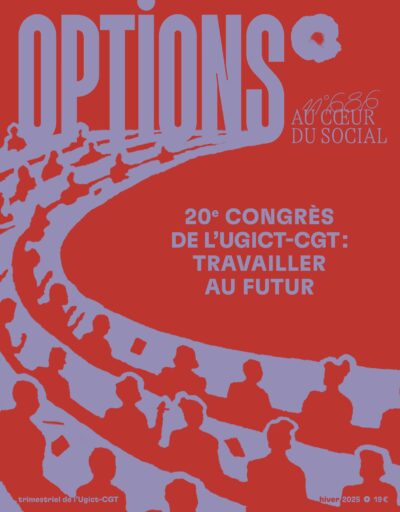Des collectivités territoriales telles que Strasbourg, Grenoble, Arras, Saint-Ouen ou Gentilly ont souhaité instaurer, par délibération, la reconnaissance d’un droit à un congé menstruel sous forme d’autorisation spéciale d’absence (Asa). En réaction, la Direction générale des collectivités locales (Dgcl) a transmis aux préfets une circulaire, datée du 21 mai 2025 (1), leur demandant de s’opposer systématiquement à ces initiatives dans le cadre de l’exercice de de leur contrôle de légalité.
Ladite circulaire précise que le cadre statutaire des agents publics territoriaux, tel que défini par le Code général de la fonction publique (Cgfp), ne permet pas aux collectivités et établissements publics locaux de créer de nouvelles catégories d’Asa pour des raisons de santé. Une telle décision, estime la Dgcl, relève du législateur ou du pouvoir réglementaire national et non des assemblées délibérantes locales.
L’argumentation de la Dgcl
Cette administration centrale note que l’article 34 de la Constitution de la Ve République indique que « la loi fixe […] les règles concernant […] les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ». Or, parmi ces garanties, figurent les Asa que le juge administratif a considérées comme étant l’un des éléments du statut des agents.
En outre, s’appuyant sur une réponse ministérielle (2), la Dgcl affirme qu’il revient au législateur d’instituer les motifs d’autorisations d’absence qui peuvent, le cas échéant, être déclinés par le pouvoir réglementaire, dans le respect du principe de parité avec les Asa de la fonction publique d’État. Aussi, le pouvoir réglementaire a complété et enrichi la liste ou les motifs permettant à un agent de s’absenter, soit de droit, soit sous réserve des nécessités de service (par exemple, pour motifs religieux).
Les agents titulaires, stagiaires ou contractuels, à temps complet ou non, en position d’activité peuvent, sur ce fondement, être autorisés à s’absenter de leur service dans un certain nombre de cas déterminés.
Les Asa constituent ainsi une des modalités d’aménagement du temps de travail accordées à titre exceptionnel et ponctuel sans utiliser les droits à congés des agents, indique la Dgcl. Celle-ci distingue deux catégories d’Asa :
- d’une part, les « Asa de droit » qui s’imposent à l’autorité territoriale ;
- d’autre part, celles accordées par l’autorité territoriale sous réserve des nécessités de service. Les motifs justifiant ces Asa concernent principalement la parentalité, les événements familiaux, les événements religieux et les activités syndicales.
Le cadre légal en vigueur ne prévoit cependant aucun motif de santé non liée à la parentalité, qui justifierait le bénéfice d’une Asa, indique la Dgcl.
Elle poursuit en précisant que le pouvoir réglementaire dévolu à l’autorité territoriale lui permet de décliner les Asa légalement créées et de définir les conditions d’octroi ou les caractéristiques des autorisations d’absence dans le respect du principe de parité avec la fonction publique d’État.
Elle en conclut que le pouvoir réglementaire, a fortiori local, est incompétent pour créer un motif d’autorisation d’absence. En effet, le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales s’exerce dans les bornes d’une compétence définie par la loi et doit avoir un fondement législatif (3).
Enfin, la Dgcl relève que plusieurs décisions de justice récentes (4) ont suspendu les créations, par des collectivités territoriales, d’Asa « congé menstruel » car elles étaient sans lien avec les motifs « parentalité » et « événements familiaux » fixés par les dispositions législatives et réglementaires. Ainsi, le tribunal administratif de Grenoble a récemment jugé en référé que les Asa « congé menstruel » ne peuvent être légalement fondées sur les dispositions de l’article L. 622-1 du Cgfp (5) car elles sont sans lien avec les catégories « parentalité » et « événements familiaux ».
La Dgcl rejette également le recours à l’expérimentation locale prévue par la Constitution pour que les collectivités créent une nouvelle catégorie d’Asa.
En effet, certaines collectivités territoriales ou leurs établissements ont souhaité créer de nouveaux motifs d’Asa, dont celui relatif au congé menstruel, par le biais des expérimentations locales prévues par l’article 72 de la Constitution de la Ve République. Ces expérimentations permettent aux collectivités territoriales et à leurs établissements de déroger aux dispositions législatives qui régissent l’exercice de leurs compétences. Mais la Dgcl rétorque qu’elles doivent être préalablement autorisées par une loi qui doit, notamment, préciser l’objectif visé, identifier les règles législatives auxquelles les collectivités ou établissements peuvent déroger pendant l’expérimentation, déterminer les catégories et caractéristiques spécifiques de ces collectivités, et limiter l’expérimentation à une période de cinq ans maximum. Dans ces conditions, estime la Dgcl, en l’absence de base légale, de telles délibérations sont illégales.
Les préconisations de la Dgcl
Outre le fait que la Dgcl demande aux préfets de déférer devant le tribunal administratif toute délibération d’une collectivité locale créant de nouveaux motifs d’Asa, l’administration centrale propose des solutions alternatives pour le moins pénalisantes.
En premier lieu, elle indique qu’en l’état actuel du droit, le dispositif des congés de maladie paraît être l’outil statutaire le plus adapté, notamment le recours au congé de maladie ordinaire (Cmo) fractionné. Mais elle reconnait que, conformément, aux dispositions de l’article L. 822-3 du Cgfp, la fonctionnaire territoriale ainsi placée en Cmo fractionné ne percevra que 90 % de son traitement (ou 50 % s’il excède trois mois sur l’année calendaire). Par ailleurs, le maintien du régime indemnitaire dépend des conditions fixées par les délibérations des collectivités territoriales ou établissements publics locaux, dans les limites prévues pour les agents de la fonction publique d’État, en application du principe de parité.
La reconnaissance du droit au congé menstruel passera par la loi
En outre, elle rappelle que collectivités et établissements concernés peuvent faciliter les aménagements avec, notamment, le recours au télétravail. Ainsi, pour les agents dont les fonctions peuvent faire l’objet de télétravail, la quotité de jours télétravaillés peut être supérieure à trois par semaine pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé le justifie et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail. Cette dérogation étant renouvelable. On notera cependant que, dans une commune, par exemple, il peut y avoir moins de 10 % du personnel (hommes et femmes) qui accomplissent des missions éligibles au télétravail.
La seule issue permettant de régler ce problème, sauf à reconnaître aux collectivités territoriales une véritable autonomie de gestion, passe par l’adoption d’un texte législatif qui créerait ce type d’Asa pour les trois versants de la fonction publique.
- Circulaire Dgcl du 21 mai 2025, relative au contrôle de légalité des délibérations instaurant des autorisations spéciales d’absence pour des congés relatifs à la « santé menstruelle ou gynécologique », n° 25-004414-D.
- Réponse écrite à la question n° 22676, publiée au Journal officiel Sénat du 7 juillet 2016.
- Conseil d’État , avis, 15 novembre 2012, n° 387 095.
- Ordonnances n° 2500479 et n° 2500481 du tribunal administratif de Grenoble, 17 février 2025 et ordonnances n° 2406364, n° 2406581 et n° 2406584 du tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 20 24.
- Article L. 622-1 du Cgfp : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité, notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225-16 du Code du travail. et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence sont sans effet sur la constitution des droits à congés annuels et ne diminuent pas le nombre des jours de congés annuels. »