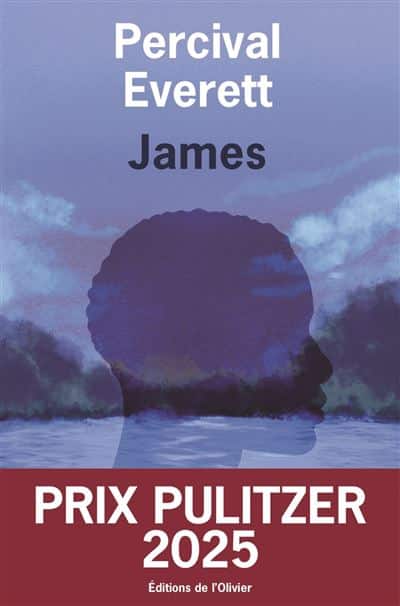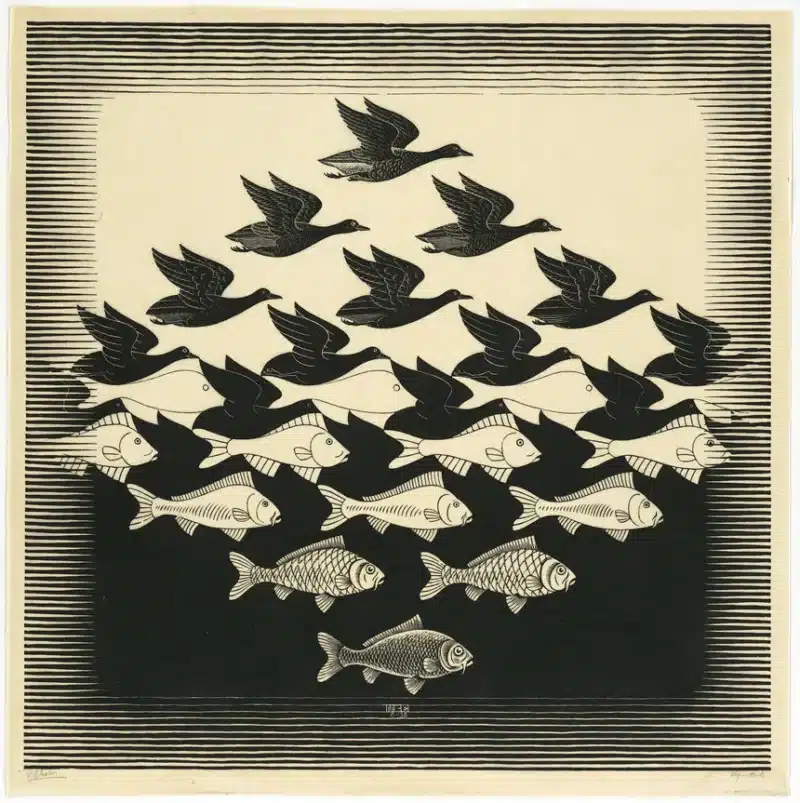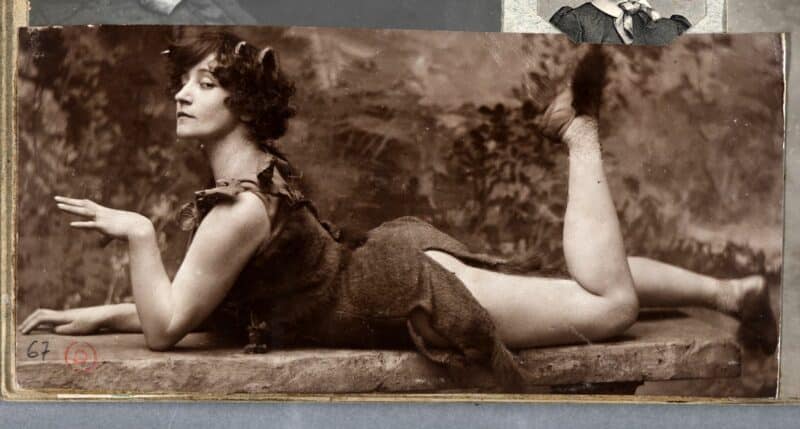Dans L’Étranger d’Albert Camus, Meursault assassine un Arabe de cinq coups de feu, un dimanche après-midi, aux abords d’Alger. L’Arabe n’a qu’une identité – être arabe –, il n’a ni nom ni prénom. En 2014, Actes sud publie un premier roman au titre évocateur : Meursault, contre-enquête. L’auteur, Kamel Daoud nomme l’Arabe Moussa Ouled El-Assasse, afin qu’il ne soit pas juste un faire-valoir, un simple figurant, une convenance littéraire, une banale utilité romanesque. Dans un bar d’Oran – un bar alcoolisé – c’est un vieux monsieur, Haroun, qui raconte la vie de Moussa. Car Moussa, c’est son frère. Il précise : « Songes-y, c’est l’un des livres les plus lus au monde, mon frère aurait pu être célèbre si ton auteur avait seulement daigné lui attribuer un prénom, bon sang !…Mais non, il ne l’a pas nommé, parce que sinon, mon frère aurait posé un problème de conscience à l’assassin : on ne tue pas un homme facilement quand il a un prénom. »
Dans ce qui ressemble à une confession adressée à un étudiant « camusien », Haroun confie que lui aussi a tué, sans raison apparente. Il devient un double de Meursault, et Kamel Daoud signe un hommage à Camus (« tu as dû lire cette histoire telle que l’a racontée l’homme qui l’a écrite. Il écrit si bien que ses mots paraissent des pierres taillées par l’exactitude même »), une suite à L’Étranger, un point de vue salutaire, et fête la littérature (« Je crois que je devine pourquoi on écrit les vrais livres. Pas pour se rendre célèbre, mais pour mieux se rendre invisible, tout en réclamant à manger le vrai noyau du monde ») !
David Copperfield dans un mobil-home des Appalaches
Quelques années plus tard, la romancière américaine Barbara Kingsolver, de passage en Angleterre, a séjourné dans un bed & breakfast au bord de la mer du Nord. Mais ce bed & breakfast n’était pas n’importe lequel, c’était l’ancienne maison de Charles Dickens. Elle a alors eu l’idée de transposer un des romans les plus célèbres de l’écrivain anglais, David Copperfield (1849). Ainsi est né Demon Copperhead paru en français en 2024 chez Albin Michel sous le titre On m’appelle Demon Copperhead.
Barbara Kingsolver emmène Charles Dickens aux États-Unis, dans les Appalaches, un ancien pays minier, un monde rural, et partage avec lui les injustices en tous genres du XXIe siècle… Demon Copperhead naît dans un mobil-home, orphelin de père et d’une mère junkie : « Déjà, je me suis mis au monde tout seul. Ils étaient trois ou quatre à assister à l’évènement, et ils m’ont toujours accordé une chose : c’est moi qui ai eu à me taper le plus dur, vu que ma mère était disons, hors du coup. […] Je vous parle d’une gamine de 18 ans, seule dans la vie et enceinte jusqu’au cou. Alors le jour où elle ne s’est pas pointée sur la terrasse, c’est Nancy Peggot qui a dû aller cogner à sa porte, débouler à l’intérieur et la trouver dans les vapes avec son matos éparpillé par terre, et moi déjà en train de sortir. Otage gluant couleur de poisson, récoltant la poussière sur le carrelage en vinyle, à pousser et me tortiller comme un ver parce que je suis encore à l’intérieur de la poche où flottent les bébés : la vie avant la vraie vie. »
Dépendant aux opiacés
Le ton est donné, il éclabousse en pleine crise des opioïdes : l’Oxicontin produit par Purdue Pharma a fait la fortune de la famille Sackler, mais a surtout tué quelques centaines de milliers d’États-Uniens. Il a été prescrit en masse, en tant qu’antidouleur, par des médecins auxquels on en avait caché les effets addictifs, tout en leur proposant des séjours à Hawaï. Demon Copperhead devient dépendant aux opiacés, il est « un gamin de 10 ans qui se défonce aux cachetons. Pauvres mômes. On est censés dire, regardez-les, ils ont fait de mauvais choix qui les a conduits à une vie de misère. Mais des vies se vivent là, en cet instant précis, se glissant entre les brossez-vous-les- dents, les-bonne-nuit-les-petits et les chariots de supermarché remplis à ras bord, où ces mots n’ont pas cours ».
Mais l’entraide, la solidarité et une irrésistible envie de rester en vie font de ce roman autant un terrible témoignage sur les conditions de vie de ces invisibles que sur le courage qu’ils développent. Barbara Kingsolver leur donne sa plume, elle a écrit son propre David Copperfield, dans d’autres temps et autres lieux, et laisse toujours poindre l’humanité : « Cette petite lumière, je vais la laisser briller (doigt levé comme une bougie). Ne laissez pas Satan la souffler », énonce Demon, une phrase que David aurait pu faire sienne…
James, esclave en fuite et narrateur principal
Percival Everett lui, construit un remake du roman de Mark Twain, Les Aventures d’Huckleberry Finn (1884). Comme Barbara Kingsolver, il « emprunte » l’œuvre d’un auteur du XIXe siècle. Comme Kamel Daoud, il déplace le point de vue : lorsque Huckleberry Finn veut échapper à la violence de son père, il descend le grand fleuve en canoë jusqu’à l’île Jackson. Au bout de quatre jours, il découvre ne pas être seul sur cette île : un vieil esclave s’y cache, en fuite… Perceval Everett renverse les rôles ; il raconte la même aventure, mais du point de vue de l’esclave, Jim, ou plutôt James.
Donc James devient le narrateur (« un esclave est « beaucoup plus facile à entretenir qu’un chien […]. Ils ne laissent pas de déjections partout dans lesquelles on marche. Ils ne pissent pas dans les coins. Ils ne chassent pas les putois ni les porcs-épics »). Il déconstruit le racisme systémique de la société américaine, ne serait-ce qu’avec son envie d’être. Et pour être, il faut s’armer du langage et des mots. Mais face aux Blancs, pour que ces derniers se sentent maîtres, James – comme tous les esclaves – fabrique une langue de dominé, parle « petit nègre », faisant disparaître la lettre r : « Moi je connais une seule façon de pa’ler, Huck, Mais tu me fais peu’ là. Tu veux di’e quoi, je pa’le biza’e ? » Car James sait que « les Blancs s’attendent à ce que nos paroles sonnent d’une certaine façon et, forcément, mieux vaut ne pas les décevoir. Quand ils se sentent inférieurs, nous sommes les seuls à souffrir. Peut-être devrais-je dire “Quand ils ne se sentent pas supérieurs” ». Une façon presque aimable de dire la bêtise du racisme…
Le long du « grand bourbier » qu’est le Mississipi
Qui est dupe de qui ? Car James sait lire, écrire… Et dans ses rêves, il dialogue avec Voltaire et Locke. Il manie les mots, il est. Dans cette odyssée (respectueuse du roman de Mark Twain), difficile de ne pas dériver en compagnie du duo le long du « grand bourbier » (surnom donné au Mississipi), de ne pas aborder cette peinture de l’Amérique dite profonde. Faire la traversée entre le monde noir et le monde blanc, vivre les péripéties des deux compères, s’amuser des facéties de l’histoire, aimer autant James et Huck que l’auteur les a chéris, questionner l’identité, la responsabilité, la violence, voilà la promesse tenue de James, dernier roman de Percival Everett.
Et James de constater qu’« en cet instant, le pouvoir de la lecture m’apparut clairement dans toute sa réalité. Si je voyais les mots, alors personne ne pouvait contrôler ces mots ni ce que j’en retirais. On ne pouvait même pas savoir si je les voyais seulement ou si je les comprenais dans leur globalité. C’était une pratique absolument intime, absolument libre, et par conséquent absolument subversive ».
Un « prince de Zamunda » à Paris
Berado est un jeune Congolais qui vient de débarquer à Paris, afin de rejoindre un ami d’enfance disparu. Rapidement, il se fait appeler « prince de Zamunda », en référence à Eddie Murphy (Un prince à New York). Il a l’air paumé mais sa roublardise, son charme, sa verve et une certaine habileté lui donnent le sens de la démerde… jusqu’à l’embrouille chez un certain Ramsès, le réceptionniste du Salam Hôtel, dans le XIe arrondissement.
Drôle, facétieux, joueur, écrit comme un flux continu volontairement avare de grammaire. Ramsès de Paris, le roman d’Alain Mabanckou, laisse Berado narrer ses exploits jusqu’à la prison de la Santé, sous le numéro d’écrou 470655. Mais chaque chapitre est un hommage à un livre ou à un film : de Bonjour tristesse aux Raisins de la colère, des Cigares du pharaon à La Vie mode d’emploi, de L’Amant aux Liaisons dangereuses et à La Disparition… Un roman farceur, fripouille, qui sait ce que « flamber » veut dire.
- Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête, Folio, 2023 [2014], 208 pages, 8 euros.
- Percival Everett, James, Éditions de l’Olivier, 2025, 288 pages, 23,50 euros.
- Barbara Kingsolver, On m’appelle Demon Copperhead, Albin Michel, 2024, 624 pages, 23,90 euros.
- Alain Mabanckou, Ramsès de Paris, Seuil, 2025, 272 pages, 21 euros.