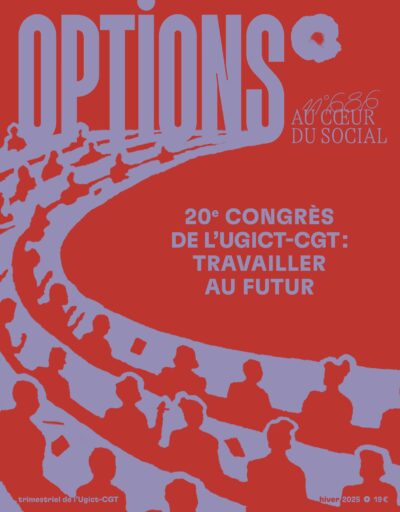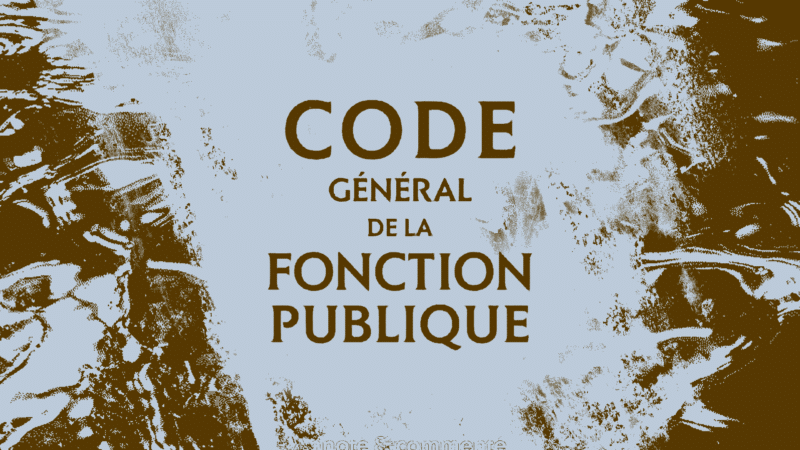« D’une manière ou d’une autre, les cadres doivent rester connectés au travail jusqu’à 70 ans. » L’assertion émane de Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d’investissement (Bpi France), dans une tribune parue en mars dans Les Échos. Selon lui, « avec l’allongement de l’espérance de vie, la retraite devient une forme de rente d’inactivité pour des personnes en bonne santé ». Alors ? Les cadres devraient-ils vraiment rester en activité à un âge aussi tardif ?
Ce serait balayer les résultats d’une récente enquête Ifop selon laquelle un tiers des salariés français subissent un état de mal-être mental (indicateur Who-5 de l’Organisation mondiale de la santé). Les trois quarts des personnes interrogées y déclarent ressentir un trouble de santé mentale lié à leur travail au cours des cinq années précédentes ; un tiers a même vécu un syndrome d’épuisement professionnel. Pire : dans les services de ressources humaines, 45 % des personnels ont déjà dû s’arrêter quelques jours pour des raisons de santé mentale, 9 points de plus que l’ensemble des salariés (36 %). Si, pour 67 % des répondants, le premier facteur impactant la santé mentale est le travail, cette proportion atteint 77 % chez les cadres…
À lire : Infographie : le mal-travail nuit à la santé mentale
« Il y a un défaut d’évaluation des risques psychosociaux, analyse Agathe Le Berder, secrétaire générale adjointe de l’Ugict-Cgt. De manière générale, l’employeur ne fait que les mentionner, mais sans détailler les six facteurs de risque. L’évaluation n’est donc pas précise. » D’année en année, les baromètres de l’Ugict-Cgt l’ont mis en évidence : chez les cadres, comme chez nombre de professions intermédiaires, l’intensité et la charge de travail ne sont pas pas évaluées. « C’est ainsi qu’on manque de capacité à agir », souligne-t-elle.
Aux risques psychosociaux (Rps), l’Ugict préfère d’ailleurs la notion de « risques socio-organisationnels » : « C’est en effet l’organisation du travail qui est délétère pour la santé mentale des salariés, et cela relève de la prérogative de chaque entreprise, pointe la secrétaire générale adjointe de l’Ugict-Cgt. Là où on réussit à gagner des choses, c’est quand on engage un rapport de force dans une situation de crise. » Ce constat fait écho aux enseignements de l’enquête Ifop montrant que « les politiques de prévention restent encore centrées sur la réaction face aux situations d’alerte plutôt que sur la prévention en profondeur de l’apparition des risques psychosociaux ».
Les risques psychosociaux comme facteur de pénibilité
L’enquête sur les Rps de la direction de Nemera Services (110 salariés au siège, Lyon) en est une illustration. « Un collègue du service informatique faisait quasiment le travail de deux personnes ; malgré ses alertes, la direction n’a pas voulu scinder son poste, témoigne Joëlle Richol, déléguée du personnel pour la Cgt. Il a quitté l’entreprise, mais la direction ne voulait qu’une personne pour le remplacer. Tant que ça passe, peu importe la souffrance du salarié ! En comité social et économique (Cse), comme il ne devait pas être le seul dans ce cas, on a proposé une enquête Rps par un cabinet spécialisé. »
Finalement, la direction a commandé un sondage sur les Rps auprès d’un prestataire. « Ce dernier a effectivement montré qu’il y avait trop de charge de travail ; des postes ont été créés, poursuit Joëlle Richol. Si cela nous paraît satisfaisant, nous restons vigilants, en particulier sur la prise en compte, dans la rédaction du nouveau document unique, des six facteurs de Rps. » À savoir : l’intensité et la charge de travail, les exigences émotionnelles, le manque d’autonomie, les rapports sociaux au travail dégradés, les conflits de valeurs et l’insécurité de la situation de travail. Mais si les effets du travail sur la santé mentale, tout comme ces six facteurs de risques psychosociaux, sont clairement établis, le Code du travail (article L4161-1) ne reconnaît toujours pas, de manière officielle, les Rps comme facteurs de risques professionnels.
Pénibilité et retraite : comment font les autres ?
Éditrice d’un « sociomètre de l’encadrant », dont la conception est le fruit des travaux de l’Ufict services publics sur la base d’une échelle comparative permettant de définir un environnement « de qualité, hostile, ou de rupture », l’Ugict-Cgt plaide pour la reconnaissance des risques psychosociaux avec l’adoption d’une directive européenne sur ce thème. Plusieurs pays se sont déjà engagés dans cette voie, montre l’étude « Pénibilité du travail et retraite, une comparaison internationale des dispositifs existants », réalisée par l’économiste Annie Jolivet (Cnam, mars 2023). Trois pays européens s’y distinguent par la prise en compte de la charge mentale et émotionnelle dans l’appréhension de la pénibilité du travail. Ainsi la Pologne considère-t-elle que l’existence d’une responsabilité spécifique ou d’une forte pression psychophysique induit un « travail à caractère particulier ». Des éléments que l’économiste rapproche de la « charge mentale (pour des activités de travail nécessitant une forte concentration et des décisions sous contrainte de temps), voire de la charge émotionnelle ».
La chercheuse retrouve cette idée en Finlande, avec deux conditions : «Un travail interactif particulièrement exigeant, nécessitant un effort mental exceptionnel » et un « travail nécessitant d’être constamment sur ses gardes ou particulièrement vigilant et comportant des risques élevés ou dans lesquels la menace de violence est marquée ». Enfin, en Belgique, les critères de pénibilité physique peuvent se cumuler avec la charge mentale ou émotionnelle, mais cette charge ne peut à elle seule déclencher une reconnaissance de la pénibilité au travail.
Au-delà de l’« usure physique »
« Se sentir capable de faire le même travail jusqu’à la retraite et le souhaiter est loin d’être seulement une question d’usure physique », écrit ainsi Annie Jolivet dans une autre étude de 2020 sur la soutenabilité du travail (1). Les enquêtés, âgés de 47 à 61 ans, ont été répartis selon cinq configurations : les « épargnés » ; celles et ceux qui ont un travail « physique et peu de soutien » ; « physique et décalé » ; « pénible et contraint » ; « sous pression ».
C’est dans cette dernière catégorie que l’on retrouve les personnes les moins capables et/ou désireuses de faire le même travail jusqu’à la retraite : plus féminisées et plus diplômées que l’ensemble de la population, elles sont souvent cadres ou professions intermédiaires. Certes à l’abri des contraintes physiques, mais exposées à des contraintes temporelles, au manque de ressources et à un contexte changeant.
- Annie Jolivet, Anne-Françoise Molinié, « Travailler plus tard est-il aussi soutenable pour les femmes que pour les hommes ? Une analyse à partir des enquêtes Conditions de travail 2013 et 2016 », Socio-économie du travail n° 8, 2e semestre 2020.