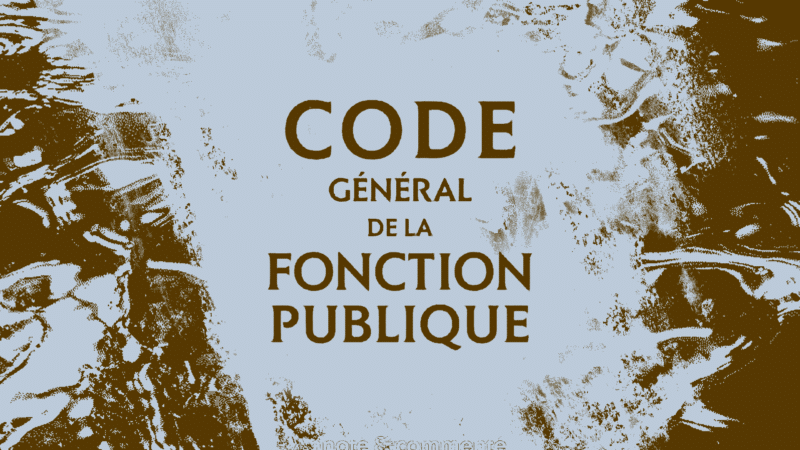– Options : la dette publique française représentait 20 % du PIB en 1980, elle pèse 115,6 % aujourd’hui. Comment expliquer cette trajectoire ?
Il y a plusieurs causes à cet accroissement. D’abord, les taux d’intérêt ont été supérieurs au taux de croissance économique durant les années 1980 et 1990, ce qui a entraîné un effet boule de neige. Ensuite, les gouvernements ont mené dans les trois dernières décennies une contre-révolution fiscale et l’État s’est privé de ressources au profit des ménages aisés et des entreprises. Le coût direct et indirect de la crise financière de 2007-2008, pris en charge par l’État afin de sauver le système financier privé, a également joué. Tout comme, en 2020, la décision de l’État de prendre les mesures de soutien nécessaires à la lutte contre le Covid-19.
– Ce niveau est-il extrêmement préoccupant ?
Deux réalités doivent être prises en compte. D’abord, l’État ne « rembourse » jamais sa dette. Il la renouvelle dès que les titres émis par lui arrivent à échéance. L’expression qu’on emploie pour désigner cette particularité (« faire rouler la dette ») ne doit pas être comprise péjorativement. C’est absolument dans la nature de l’État de ne pas avoir d’horizon de vie fini, comme les entreprises et les ménages qui doivent, eux, rembourser leurs emprunts. Ensuite – et ce point ne doit pas être négligé – l’État doit payer des intérêts. C’est ce qu’on nomme la « charge de la dette ». C’est cette charge qu’il faut surveiller : les 60 milliards d’euros environ versés dans l’année aux créanciers seraient en effet mieux employés à résoudre les problèmes sociaux et écologiques.
– Comment, alors, analysez-vous le recours incessant à la métaphore du « chaos » pour parler de la dette publique ?
En premier lieu, l’accroissement de la dette ne provient pas de l’augmentation des dépenses publiques, mais de la diminution des impôts au regard des besoins collectifs. D’autre part, et ce point est crucial, l’acharnement des libérales et des libéraux à réduire les dépenses publiques et sociales signifie la volonté de réduire l’espace des services publics non marchands pour, au contraire, élargir un espace où le capital peut prendre pied et se valoriser. Ce faisant, ils et elles oublient deux choses essentielles : primo, les dépenses publiques font œuvrer les entreprises privées (exemple : si un hôpital est construit, c’est le privé qui le fait) ; secundo, une fois construit, l’hôpital est le lieu de travail de soignantes et soignants qui ajoutent une valeur dans l’économie, valeur qui n’est donc pas soustraite à l’activité privée, comme l’annoncent les illettré·es économiques.
– Quels arguments pour contrer ce catastrophisme ? Est-il vrai, par exemple, que la dette et sa charge obèrent l’avenir des générations futures ?
Si on transmet une dette à l’avenir, on transmet aussi une créance. L’important est donc de savoir à qui est transmise cette créance et qui paiera les intérêts. Si la fiscalité est juste, ce seront les riches qui paieront, par leurs impôts, ces intérêts à celles et ceux qui ont souscrit aux emprunts publics, c’est-à-dire à eux-mêmes ou à leur descendance, ou à leurs représentant·es bancaires. Si la fiscalité est injuste, ce sont les pauvres qui paieront des impôts pour verser des intérêts à celles et ceux qui y ont échappé, ce qui leur aura permis de prêter à l’État. N’est-ce pas une jolie boucle du circuit économique ?
– Au fond, à quoi sert la dette, et à qui profite-t-elle ?
À la délégitimation de la dette publique, il faut opposer l’idée que, face au « passif financier » public, il y a un actif encore plus grand constitué par toutes les infrastructures publiques (hôpitaux, écoles, lycées, universités, gares…). L’actif public est égal à 150 % du PIB. Malheureusement, depuis l’époque néolibérale, une part des emprunts publics n’est là que pour pallier la fuite en avant financière. Ce n’est pas un hasard : l’existence d’un marché de la dette publique est le résultat d’un choix politique qui vise à faire de l’État un emprunteur comme un autre, avec l’objectif de le mettre sous la pression des marchés financiers et, ainsi, de le discipliner. C’est ce que matérialise l’interdiction faite par les traités européens aux banques centrales, la BCE en tête, de prêter directement aux États.
– PIB, dette, déficits… sont régulièrement évoqués par les tenantes et tenants de l’orthodoxie budgétaire. D’autres indicateurs seraient-ils pertinents pour évaluer la soutenabilité des finances publiques ?
Ces différents indicateurs devraient être complétés par le taux d’emploi, le taux de chômage, le taux de pauvreté, l’ampleur des inégalités, les indicateurs écologiques, etc.
– Quelles propositions devraient être défendues pour plus de justice fiscale ? Comment analysez-vous la virulence du débat sur la taxe Zucman ?
Afin d’éviter la capitulation devant les marchés financiers, il faut sortir la dette publique de l’emprise de ces marchés, ce qui suppose de reprendre le contrôle de la finance. Il faut pour cela créer un dispositif qui, comme jusqu’aux années 1980, garantira la stabilité du financement. Son cœur sera formé par un pôle bancaire public, placé au premier rang des institutions financières existantes. Il permettra aux investissements sociaux et écologiques stratégiques décidés démocratiquement de trouver, dans l’épargne populaire, une contrepartie utile. N’étant pas soumis à la logique de la rentabilité financière, ce pôle bancaire public pourra être un acheteur important et stable de titres de la dette publique.
Par ailleurs, il pourra avoir accès aux liquidités fournies par la Banque centrale européenne dans le cadre de ses opérations de refinancement, comme le permet l’article 123.2 du traité sur le fonctionnement de l’UE, les titres de dette publique constituant un actif collatéral de très bonne qualité. Les institutions financières privées doivent quant à elles être soumises à un contrôle strict et avoir l’obligation de placer une partie de leurs actifs en titres de la dette au taux fixé par la puissance publique. Quant à l’hostilité à la taxe Zucman, elle relève de la lutte des classes, que ressuscite le président du Medef en annonçant une grande « mobilisation patronale »…
- Jean-Marie Harribey est ancien professeur agrégé de sciences économiques et sociales et maître de conférences d’économie à l’université Bordeaux-IV. Il est notamment l’auteur de En quête de valeur(s), Éditions du Croquant, 2024.