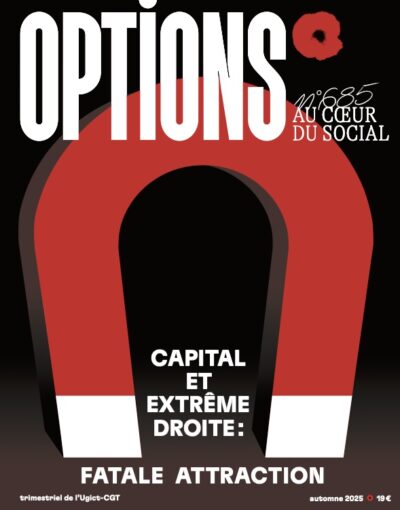« J’ai été arrêtée par la police, puis relâchée quelques heures après, sans charges », raconte Zelda Montes, 24 ans, ingénieure informatique et membre active de No Tech for Apartheid (NoTA), un collectif de salarié·es et ex-salarié·es de l’informatique, appartenant principalement à Google et Amazon.
Depuis 2021, ce groupe interpelle les deux compagnies quant au projet Nimbus, un contrat de 1,2 milliard de dollars décroché en 2021 auprès du gouvernement israélien pour lui fournir des outils de stockage à distance (cloud computing), d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique — dont les membres de NoTA pensaient qu’ils étaient utilisés dans l’apartheid, puis dans le génocide lancé en 2023 par Israël à Gaza. Sollicités, Google et Amazon n’ont pas donné suite à nos demandes de réaction.
Parmi les actions lancées par NoTA pour attirer l’attention sur le contrat Nimbus, Zelda Montes raconte avoir participé, le 16 avril 2024, à un sitting dans les locaux de son employeur — ce qui lui a coûté son arrestation puis finalement son poste. Depuis, l’ingénieure s’est engagée comme organisatrice (« organizer ») avec NoTA, qui rassemble selon elle plusieurs centaines de personnes. Elle reste convaincue de l’importance de l’action. « Quand j’ai découvert ce que faisait Google, je me suis dit que je devais agir. Beaucoup de gens se demandent ce qu’ils peuvent faire. Votre travail est votre pouvoir — même si vos employeurs font tout pour vous le faire oublier », assure-t-elle. Matthew, 29 ans, un ingénieur qui préfère garder l’anonymat, raconte aussi son engagement chez NoTA. « Ça me semble moral de me positionner contre l’utilisation de la tech comme outil rendant possible la violence. En Palestine, mais aussi ici, aux États-Unis, des solutions de stockage de données sont vendues à l’Immigration and Customs Enforcement (ICE)1 pour la surveillance et l’expulsion des personnes en situation de migration », souligne-t-il.
Sous Donald Trump, « le masque est tombé »
Google, comme d’autres, jouissait jusque récemment d’une image relativement progressiste. Le retour de Donald Trump à la présidence a changé la donne. Début janvier, le cofondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, annonçait réduire le nombre des fact-checkers du réseau social, au nom de la « liberté d’expression » — trois jours avant qu’un mémo interne n’annonce l’abandon de ses politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). À l’occasion de l’investiture, le fondateur de Tesla, Elon Musk, s’était quant à lui fendu d’un geste que beaucoup ont interprété comme un salut nazi — l’homme s’en est défendu. Il a ensuite pris les rênes du Department of Government Efficiency (DOGE), une structure gouvernementale provisoire dédiée à « l’efficacité », via laquelle il a eu accès à d’importants volumes de données personnelles, commerciales et fiscales, soulevant de nombreuses inquiétudes. Les contrats récemment passés par les différents ministères américains avec l’entreprise Palantir, spécialisée dans la collecte et le traitement de données (notamment pour des usages militaires), préoccupent également fortement les défenseurs des libertés individuelles.
« En fait, il ne faut pas s’y tromper, il n’y a pas vraiment eu de changement de la part de ces entreprises, qui n’ont pas d’autres intérêts que leurs profits », juge auprès d’Options Kevin Gallagher, ancien salarié d’Apple et représentant syndical au sein de l’International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), qui cherche à mobiliser la tech. « Bien sûr que ces compagnies cherchent à réaliser le plus de profits possible, analyse, quant à elle, Natalia Luka, sociologue à l’université de Californie à Berkeley. Mais elles sont aussi les promotrices de “l’idéologie californienne”, un ensemble de croyances techno-utopistes selon lesquelles la technologie favoriserait la démocratie, réduirait les hiérarchies et aiderait au progrès social via les nouvelles technologies de réseau. Cette tension-là a toujours existé en leur sein ». « Avec Trump, le masque est tombé », conclut Nell Geiser, directrice de recherche du Communications Workers of America (CWA).
Ce dernier syndicat a récemment créé une division dédiée à l’informatique, le CWA-CODE, qui rassemble aujourd’hui quelques milliers de salarié.es. La syndicalisation, auprès de l’IAM, de CWA-CODE ou d’autres est encore poussive, et se trouve être le fruit d’un mouvement amorcé en 2017 — justement lors du premier mandat de Donald Trump. La plus importante de ces contestations fut le « Google Walkout » en 2018 : apprenant qu’un cadre accusé de harcèlement sexuel allait toucher 90 millions de dollars de prime de départ, des milliers d’employé·es avaient décidé de débrayer. « Les travailleur.ses de la tech pensent pour beaucoup que l’utilisation de la technologie sert le bien commun. Mais quand leurs employeurs compromettent ces valeurs idéalistes, ils se sentent trahi.es », explique Natalia Luka.
Sur la base d’un corpus recensant les manifestations et contestations des débuts de l’informatique jusqu’en 2024, Natalia Luka en a analysé la nature et les évolutions. « On observe deux étapes, explique la sociologue. D’abord les salarié·es se mobilisent autour de questions éthiques, ce qui permet de créer du collectif. Puis ces collectifs, qui entrent en conflit avec le management, évoluent autour de questions liées au droit du travail. »
Le retour de la peur
Mais depuis 2022, la sociologue note un essoufflement. Il faut dire qu’en novembre de cette année-là, Elon Musk, qui venait de prendre possession de Twitter (aujourd’hui X), annonçait le licenciement de milliers de salarié·es. Dans la foulée, Meta, qui chapeaute Facebook, remerciait 11 000 personnes – soit 13 % de ses effectifs –, suivi par Amazon, avec cette fois 10 000 licenciements.
« L’IA est souvent évoquée pour justifier les licenciements de masse qui ont commencé en 2022 dans le secteur de la tech, explique à Options Samuel So, chercheur à l’université de Washington et co-auteur d’un article récent2 sur le sujet. Mais, en réalité, l’IA est un prétexte. Les raisons derrière ces licenciements sont à chercher autour de l’augmentation des taux d’intérêt et des pertes de profits associées, de l’influence positive des licenciements sur les performances boursières et des excès de recrutement pendant la période du Covid. » Le chercheur rappelle que les entreprises de la tech continuent à réaliser de substantiels bénéfices. « Il y avait un tabou autour des licenciements dans la tech. Mais dès que la première s’y est mise, toutes les autres lui ont emboîté le pas », ajoute le chercheur.
Effet collatéral, les ingénieur·es de la tech, bien payé·es et se sentant protégé·es, ont découvert leur vulnérabilité. Et le retour de Donald Trump n’a rien arrangé. « Auparavant, les salarié·es avaient le sentiment que leurs dirigeants étaient de leur côté, c’est notamment ce qui leur a donné de la force lors des premiers mouvements », remarque Natalia Luka. Aujourd’hui, ils hésitent davantage à se mobiliser. « Bien sûr que les salarié·es ont peur. Quand on organise des tables d’information devant les bureaux d’Amazon, les gens hésitent à venir nous parler. Ils craignent les représailles », confirme Mike, un ingénieur de 40 ans engagé auprès de NoTA, qui préfère lui aussi garder l’anonymat.
Chercheuse spécialisée sur les questions de technologie, de pouvoir et de résistance dans les contextes du travail à l’université Carnegie Mellon, à Pittsburgh, en Pennsylvanie, Cella Sum décrit la précarité des salarié.es de la tech. « Contrairement aux récits populaires de prestige et de privilège, les travailleur.ses de la tech évoluent dans des environnements fragmentés et instables, ce qui contribue à leur perte de pouvoir et freine leurs efforts d’organisation collective », considère-t-elle. Leur situation statutaire joue également : de plus en plus sont employé·es comme freelance, en sous-traitance. D’autres n’ont pas la nationalité américaine et œuvrent sous visa de travail. « L’impact sur leur capacité à s’exprimer est évidemment énorme », commente Cella Sum.
Nouvelles formes de mobilisation
La façon dont le syndicalisme est structuré aux États-Unis ne favorise pas non plus l’organisation. Les syndicats ne peuvent implanter une section ayant pouvoir de négociation au sein d’une entreprise qu’après l’organisation d’un suffrage. Si la majorité des employé·es votent pour la création, alors la section est créée. Mais les campagnes sont souvent l’occasion d’intenses manœuvres de désinformation de la part des employeurs, et il n’est pas rare que les créations échouent. « En fait, le système est pensé pour que ce soit difficile, explique Kevin Gallagher, du syndicat IAM. Cela signifie qu’il faut créer des sections syndicales dans chaque magasin Apple, par exemple. Et comment faire pour les travailleur.ses de bureau, qui sont disséminé·es sur plusieurs continents ? »
Certain·es salarié·es se mobilisent donc aujourd’hui au sein de collectifs informels qui ne disposent pas du pouvoir de négocier des accords d’entreprise. Chez Apple, des employé·es ont ainsi créé une structure internationale, Apple Together. « C’est une nouvelle façon de s’organiser, commente Kevin Gallagher. Ce sont des collectifs transnationaux de solidarité, hors syndicat, où l’on réfléchit plutôt à faire de l’action directe, sur le modèle européen. » Le serveur Discord du collectif regroupe à ce jour environ 1 000 personnes. « L’idée aujourd’hui, c’est uniquement de grossir », souligne le syndicaliste.
Ces nouvelles mobilisations, plus souterraines, ont aussi été identifiées par la chercheuse Cella Sum. Elle mentionne en particulier la Tech Workers Coalition, créée en 2014, qui se veut très largement ouverte — à la fois à l’international, mais aussi à l’ensemble des travailleur.ses de la chaîne. « Il est très important d’embarquer dans ces mouvements les « travailleur.ses de la donnée », celles et ceux qui travaillent, notamment en Inde, pour préparer les IA, explique-t-elle. « Il y a une impulsion aujourd’hui. Les salarié·es ont vraiment envie de s’organiser », remarque Nell Geiser, du CWA.
La presse peut aussi se pencher sur les sujets de préoccupation des salariés. Le 6 août 2025, une enquête conjointe du Guardian, du site israélo-palestinien +972 magazine et du site d’investigation Local call révélait qu’un contrat entre Microsoft et l’armée israélienne permettait à cette dernière d’intercepter chaque jour des millions d’échanges téléphoniques à Gaza et en Cisjordanie. Ce dispositif de surveillance de masse était notamment utilisé pour programmer des bombardements.
Le 25 septembre, sous pression de ses employés et de ses actionnaires, Microsoft a déclaré couper l’accès de l’unité de l’armée israélienne concernée. Brad Smith, le président de Microsoft, a admis avoir « trouvé des preuves qui corroborent certaines parties du reportage du Guardian ». L’armée israélienne prévoirait toutefois de transférer les données dans un nouvel espace de stockage cette fois fourni par Amazon, toujours selon les sources du Guardian. À suivre.
- 1 L’Immigration and Customs Enforcement (ICE) est une agence de police douanière et de contrôle des frontières, qui fait partie du département de la Sécurité intérieure des États-Unis — l’équivalent du ministère de l’Intérieur en France. Cette agence est notamment en charge des expulsions de personnes en situation de migration.
- 2 « The Cruel Optimism of Tech Work: Tech Workers’ Affective Attachments in the Aftermath of 2022-23 Tech Layoffs », 25 avril 2025.