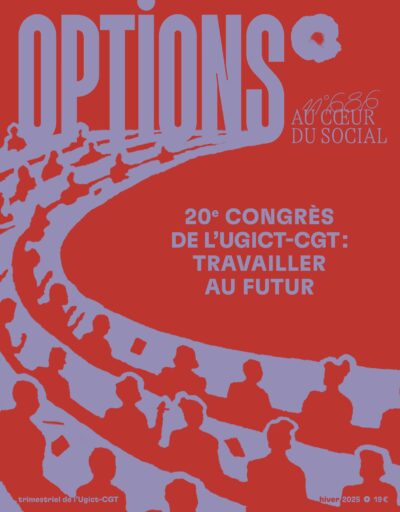La disruption est une belle promesse qui, pourtant, se solde souvent par un échec. Il ne s’agit pas ici de politique (quoi que), mais de la dure réalité économique et sociale dans laquelle l’exposition « Flops ?! » propose de voyager. Visible jusqu’en mai 2026 au Musée des Arts et métiers (Paris), elle relate l’histoire de plusieurs centaines d’innovations partiellement loupées ou totalement ratées. Mélange d’objets du XVIe siècle jusqu’à nos jours issus majoritairement des secteurs de l’aérospatiale, des transports, des jeux et des télécoms, cette déambulation thématique s’ouvre sur les ratés les plus retentissants. D’emblée, les échecs sont relativisés : multifactorielle, la faille à leur origine ne dépend pas toujours de la technologie développée.
Les incontournables
Le plus connu : le naufrage du Titanic (1912), dès son voyage inaugural. Il coûta la vie à près de 1 500 personnes alors que la réclame vantait le paquebot comme insubmersible. Le plus geek : une maquette de la DeLorean DMC-12, un coupé sportif abordable et innovant, mais dont la faible motorisation notamment a sabordé sa commercialisation (1981-1983), avant de devenir culte avec le film Retour vers le futur (1985)… Trop tard. Le plus cartésien : une horloge décimale (1793) proposant un découpage de la journée en 10h 100 minutes et 100 secondes. La fin du cauchemar des conversions de temps n’a finalement pas pu s’imposer face aux horloges de base 12, déjà trop nombreuses sur le marché.
Les plus farfelus
Plus loin, les gueules cassées de nos sociétés se rassemblent autour de failles communes. À proximité du panneau « trop dangereux », le prototype d’une « serrure à délateur » (1782). Le principe ? En cas de tentative de crochetage, un anneau sur ressort jaillit pour enserrer le poignet du cambrioleur. Insertion de clous en option. Une fausse bonne idée restée à l’état de prototype. À ses côtés, une galerie des horreurs : des fléchettes géantes de jardin dont la masse et la matière les transforment en armes ; une Barbie aux patins lumineux dont la pierre de briquet insérée peut incendier une moquette ; une poupée-nourrisson dotée d’un système de broyage des aliments… tout aussi efficace sur des cheveux et des doigts faute d’interrupteur ! Ou alors une poudre de maquillage agrémentée de radium (début XXe), élément alors à la mode, mais ô combien toxique !
Un peu moins alarmant, voici les « mal fichus ». Y figure les Google Glass (2012) – sans objet et intrusifs –, des clefs en aluminium (XVIIIe) – sans rigidité, elles perdent leur usage –, ou une maquette du Vasa (1628) – fleuron de la marine suédoise, dont les extravagances royales en ont modifié la structure provoquant son naufrage en quelques minutes.
Impossible de résister aux fous rires devant la maladresse de certaines affiches des « mauvais lancements ». Ne citons que celle illustrant une campagne du Medef (2015) où un chef d’entreprise porte une pancarte avec une flèche indiquant un sens impossible entre deux engrenages, lui conférant ainsi un air complètement benêt.
Une danse à trois : technologie, économie, société
Une cruelle réalité s’impose devant les « recalés ». Face aux lecteurs de vidéos cassettes, les technologies les plus qualitatives ne s’imposent pas dans la « guerre de format ». Les commissaires d’exposition suggèrent d’étudier plutôt le modèle économique associé. Autre illustration, le terrible exemple de Kodak. Alors qu’il développe l’appareil photo numérique (breveté en 1978), le mastodonte de la photographie sur pellicule refuse de revoir son modèle économique et dépose le bilan incapable de prendre le virage du digital qu’il a pourtant vu venir.
Le stand « Trop cher » esquisse le début d’une réflexion sur l’utilité d’une innovation à travers le rapport service rendu et coût économique. Impossible de ne pas sourire face au Juicero (2017) qui avait pour ambition d’être le Nespresso du jus de fruits. Son business modèle ? Vendre sa machine à extraction de jus 400 dollars, ainsi qu’un abonnement de livraison de sachets, 7 dollars pièce. Mais l’entreprise s’effondre lorsque l’agence Bloomberg diffuse une vidéo démontrant l’inutilité de la machine en pressant à la main ces sachets.
Plus interpellant. Le coin « faux pas » revient sur les produits ayant provoqué un tollé. Parmi eux, un haut rayé Zara avec une étoile de shérif jaune (2014) évoquant étrangement celle imposée par les nazis pour identifier les personnes juives, une Barbie Growing up Skipper (1975) dont le buste évolue de l’enfance à une poitrine (trop) généreuse laissant éclater une polémique sur l’hypersexualisation du corps féminin. Beaucoup plus léger, un faux club de golf permet d’uriner sur le green en toute discrétion, derrière un pagne en tissu attaché à la taille. Sur ces trois exemples, seul Zara a retiré son produit.
L’échec, antichambre de succès futurs
L’exposition se penche plus longuement sur certains échecs patents, notamment celui d’Aramis. Ce projet de navettes autonomes de la RATP (1970-1987) ambitionnait de proposer une alternative à la voiture individuelle. Cependant, la multiplicité des acteurs – RATP, Matra, État, Région – aux intérêts divergents, refusant le compromis et imposant des objectifs irréalistes finissent par le mener dans le mur. Un raté à relativiser face aux progrès techniques développés et notamment insufflés dans la ligne 14 (1998), première ligne à automatisme intégral.
Point d’orgue de l’exposition : au dos des objets exposés dans le pôle « trop tôt » apparaissent des innovations à succès. Parmi eux : la Pascaline (1642) – première calculatrice mécanique ratée à cause de l’irrégularité des pièces faussant ainsi les résultats – permet la naissance de l’Arithmomètre (1850). L’aspirateur Birum (1907) propose une aspiration mécanique à l’aide d’une pompe manuelle – fatigante à actionner et peu pratique –, elle inspire nos appareils modernes. Le Newton (1993-1998) – une tablette tactile d’Apple avec une interface peu fiable – annonce le premier iPhone (2007).
Le parcours invite à saisir le temps nécessaire à l’élaboration contrariée de technologies innovantes comme : la visiophonie – appeler et voir en même temps dès 1927 puis banalisé dans les années 2000 –, Internet – sortez vos mouchoirs devant les projets français des Cyclades et du Minitel –, et la voiture électrique. Un rappel important que les ruptures technologiques sont rares. La science avance davantage par tâtonnement influencée par un contexte social et politique. Le facteur temps permet, ou pas, la maturation et l’adoption des avancées.
Après le rire, quelques regrets
Cette belle exposition, qui fait parfois rire et souvent réfléchir, n’échappe pas à quelques écueils. Souvent les histoires sont très sommaires, voire simplistes. C’est notamment le cas pour les crashs de fusée où seules les failles techniques – et non les causes organisationnelles ou économiques- sont évoquées. Ainsi en est-il du crash du vol 501 d’Ariane 5 (1996) : les commissaires d’exposition résument ce « raté » à un dysfonctionnement informatique dû au logiciel de navigation d’Ariane 4 – non adapté à la trajectoire et à la puissance de l’Ariane 5 –, mais sans évoquer les raisons économiques ayant motivé cette configuration.
Occasion manquée pour les Radium girls, ouvrières étasuniennes qui, dans les années 1920, déposaient du radium sur des cadrans de montres lumineuses. Or la toxicité du produit altéra leur santé. C’est leur combat juridique contre leur employeur qui permit des avancées sociales.
Dommage également que le travail du créateur Jacques Carelman (1929-2012) s’insère dans le parcours sans véritable cohérence. Certes, une pièce entière dédiée à son catalogue d’objets introuvables, tantôt drôles, touchants ou absurdes, interroge le sens de l’innovation. Mais cette invitation à la rêverie aurait été mieux digérée en fin d’exposition.
Cela, pourtant, n’enlève en rien à la richesse de l’expérience. Dont celle de découvrir une autre étrangeté : dans cet océan de recalés, une mise en lumière des coulisses d’une réussite déroutante. Sur un écran s’affichent des échanges de mails entre deux investisseurs américains (2009). L’un tente de convaincre l’autre — sur la base de sa bonne impression — de financer le projet de jeunes entrepreneurs. Leur ambition ? Bousculer le marché de l’hôtellerie avec des matelas gonflables et des petits déjeuners chez l’habitant. Cette start-up « AirbedAndBreakfast » sera renommée ensuite Airbnb… Aujourd’hui présente dans plus de 100 000 villes par le monde, ce géant coté en bourse est aujourd’hui accusé de fragiliser l’économie de l’hôtellerie et de favoriser la pénurie de logement. Dès lors, tout comme les échecs, le succès technologique apparaît-il lui-même relatif lorsque la structure sociale s’en trouve déstabilisée…