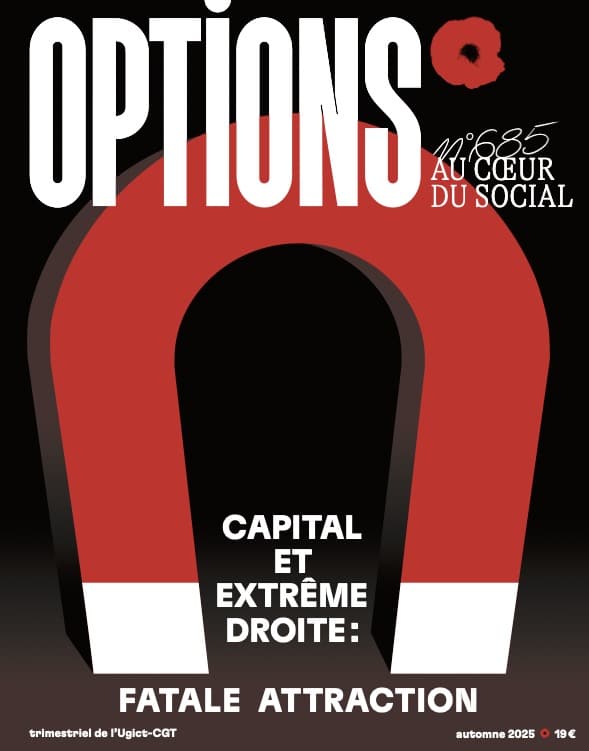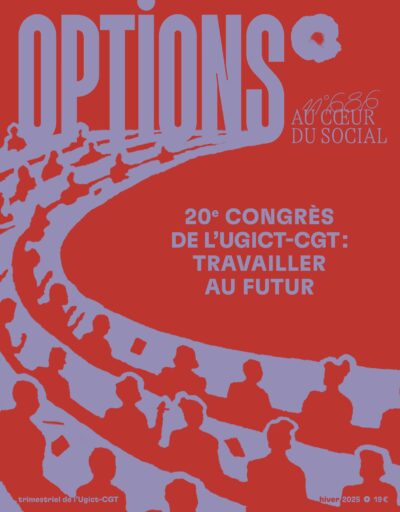Le 22 octobre 2021, dans son rapport sur le télétravail, le Sénat terminait son exposé par ce propos liminaire : « Le télétravail constitue-t-il pour autant un progrès social, ou ne risque-t-il pas de dégrader à terme la situation des télétravailleurs ? »
Quatre ans plus tard, le 31 octobre 2025, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, les députés ont voté un amendement permettant aux médecins traitants de prescrire du télétravail en lieu et place d’un arrêt maladie. Comment expliquer qu’en si peu de temps, un dispositif perçu comme un risque pour les travailleuses et travailleurs, devienne une prescription médicale ? Et, surtout, quelle signification donner à ce revirement ?
Un télétravail qui s’institutionnalise
Pour comprendre, il faut observer l’évolution du télétravail depuis la crise sanitaire. Selon les résultats de l’enquête « Télétravail, stop ou encore », de l’Observatoire du télétravail de l’Ugict-CGT, le télétravail est aujourd’hui implanté de façon pérenne dans les entreprises, et plébiscité par les salarié·es qui y ont recours : 95 % des sondé·es disent vivre plutôt bien ou très bien leur situation de télétravail.
Or, depuis quelques mois, il y a une tendance patronale à vouloir réduire, voire supprimer le télétravail. Bien que 77 % des sondé·es confirment que ce n’est pas le cas de leur entreprise, l’incitation au retour sur site est bien réelle. Ils sont 31 % à reconnaître que, lorsque l’employeur l’encourage, il le fait de manière informelle. Quoi qu’il en soit et contrairement aux annonces médiatiques qui prophétisent la fin du télétravail, celui-ci poursuit son déploiement – souvent deux jours par semaine – parmi les cadres et professions intermédiaires.
Des salarié·es qui refusent d’y renoncer
Si 54 % des salarié·es envisageraient de quitter leur entreprise en cas de suppression du télétravail, ils sont également 52 % à déclarer qu’ils démissionneraient même si on leur proposait, en contrepartie, une réduction du temps de travail sans perte de salaire !
Preuve s’il en est que, pour une majorité, le télétravail n’est pas monnayable et ne résulte pas d’une volonté de réduire le temps de travail. Ces éléments font partie de l’équation, mais ne sont des conditions ni nécessaires ni suffisantes pour expliquer son attrait auprès des salarié·es.
Ce qui semble emporter l’adhésion est la possibilité d’organiser son temps au profit de sa vie personnelle de façon plus autonome. Une volonté contrariée à la marge par un patronat toujours attaché à une culture d’entreprise où la vie personnelle doit être assujettie aux exigences de l’entreprise, et non l’inverse.
Un atout santé ?
En plus d’être incontournable, il s’avère bénéfique pour la santé. Selon la Dares, les télétravailleuses et télétravailleurs seraient globalement en meilleure santé que les salarié·es sur site. Un constat confirmé par l’observatoire, dont l’enquête révèle que 75 % des personnes interrogées se sentent moins fatiguées en télétravail.
Plus inquiétant, il s’avère être un outil à même d’éviter la prescription d’arrêts maladie, avec le consentement des salarié·es. Ainsi 76 % des sondé·es affirment avoir déjà télétravaillé tout en étant malades.
C’est à ce titre, et forts de ces constats, que les parlementaires sensibles au lobbying patronal justifient la prescription de télétravail en guise d’arrêt de travail.
En dépit des raisons qui sont à l’origine de la proposition de l’amendement, il signifie surtout, l’impérieuse nécessité, pour les syndicats, d’informer les hommes et femmes politiques sur les enjeux du droit du travail ou, plus prosaïquement, sur les conditions réelles de travail et d’emploi des concitoyennes et citoyens.
Car dans cet amendement, sur le fond comme sur la forme : rien ne va.
Une prescription de travail à une personne malade
L’article L 162-4-6 stipule : « En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail… »
Ce qui, en langage courant, signifie qu’un médecin pourrait désormais prescrire du travail à une personne malade. À moins de considérer que le télétravail ne serait pas du travail, ou qu’il existerait un état transitoire entre « être malade » et « presque malade », cette première partie d’article est au mieux mal écrite, au pire mal pensée. Dans tous les cas de figure, elle représente une régression en matière de droits des travailleuses et travailleurs.
Le contentieux juridique en embuscade
Si cet amendement devait être validé par l’Assemblée nationale, on imagine déjà la difficulté des médecins traitants dans l’obligation, avant de poser un diagnostic, de définir le degré d’intensité de la maladie, de prescrire du télétravail plutôt qu’un arrêt maladie, en espérant que l’état de santé du patient dont il a la responsabilité ne s’aggrave pas !
Les parlementaires ont tenté d’esquiver cet écueil en précisant : « Cetteprescription s’effectue avec l’accord de l’assuré. »Une précision censée protéger médecins comme employeurs, mais qui relève du vœu pieu. En réalité, en cas de détérioration de la santé du ou de la salariée, celle-ci pourra toujours se retourner contre son médecin, prétextant un mauvais diagnostic l’empêchant de choisir en conscience entre télétravail et arrêt maladie. Situation ubuesque, où la ou le patient devient coprescripteur sans avoir suivi d’études de médecine.
De même, le ou la salariée pourra se retourner contre son employeur qui, en l’application de l’article L-4121-1, est responsable de sa santé et de sa sécurité, en l’accusant d’avoir fait preuve de négligence en sous-estimant son état de santé.
Le fallacieux argument du consentement
Une mise à niveau des parlementaires est aussi nécessaire pour éviter l’utilisation, en matière de relation de travail, des termes « choix », « liberté de choix » ou encore « consentement ». Ces notions sont inexistantes en situation de subordination à un employeur.
En effet, parmi les sondé·es qui ont déjà télétravaillé tout en étant malades, 36 % l’ont fait faute d’avoir pu consulter un médecin, 32 % l’ont fait pour travailler malgré des symptômes légers liés à une maladie chronique, 28 % en raison d’une charge de travail trop importante, et 27 % pour éviter une perte de salaire.
Soudainement, la notion de liberté devient tout à fait relative et semble relever surtout du « surprésentéisme », cette tendance à travailler malgré un état de santé altéré. Phénomène déjà bien documenté et qui produit des effets délétères connus : prolongation des maladies, aggravation de la fatigue, perte de productivité à moyen terme… Autant de coûts différés pour la Sécurité sociale que la mesure prétend réduire. Que les parlementaires en charge de légiférer les relations de travail ignorent ou feignent de l’ignorer est particulièrement inquiétant.
Où est la prévention ?
Depuis plusieurs décennies, les politiques publiques, en France comme en Europe, s’appuient sur une logique centrée sur l’offre, privilégiant la compétitivité et la réduction des dépenses sociales. Le résultat est connu : dévalorisation du travail, baisse du pouvoir d’achat et des retraites, dégradation des conditions de travail, hausse des arrêts maladie.
Dans ce contexte, ces arrêts sont désormais considérés comme un poste de dépenses à « optimiser ». Selon la Caisse nationale d’assurance maladie, le coût des indemnités journalières dépasse les 10 milliards d’euros par an, conséquence directe d’une hausse de 41 % de l’absentéisme en cinq ans dans le secteur privé.
Les cadres, et plus particulièrement les femmes, sont les plus touchés par la détérioration des conditions de travail, avec une hausse de 9 % de leur taux d’absentéisme rien qu’en 2024. Enfin, si les causes des arrêts de longue durée sont multiples, les troubles psychologiques en constituent désormais la principale origine (Datascope 2025, Axa France).
Face à cette situation, l’Ugict-CGT dénonce les mesures qui visent à transférer de l’État aux individus la responsabilité économique du soin. Nous revendiquons une reconnaissance des risques socio-organisationnels comme facteurs de pénibilité, notamment pour les cadres, ingénieur·es et professions intermédiaires soumises à la pression de la performance, aux injonctions contradictoires et au stress chronique menant à l’épuisement professionnel.
Mais la reconnaissance ne suffit pas. Pour enrayer l’explosion des arrêts maladie, l’Ugict-CGT exige la mise en œuvre de véritables politiques de prévention des risques socio-organisationnels.