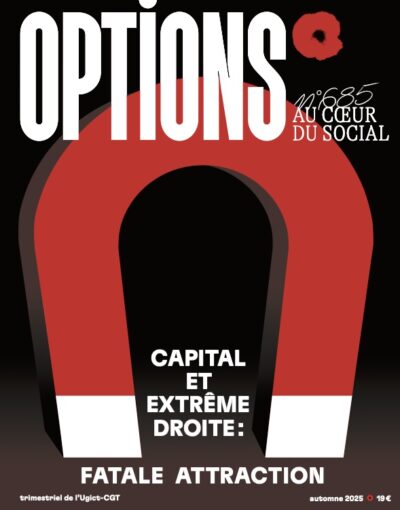Transition écologique, désordres géopolitiques, révolution technologique, montée de l’extrême droite… C’est bien au pluriel que se conjuguent les nombreux basculements auquel notre société est confrontée. Concernant le monde du travail, Christine Chiffre, secrétaire nationale de l’Ufict-Métallurgie et membre de la commission du document d’orientation du congrès, met l’accent sur un aspect majeur de ce basculement : la financiarisation extrême de l’économie et ses conséquences. « Objectifs chiffrés, déconnexion du réel, injonctions contradictoires, incohérences entre le travail prescrit et le travail réel, énumère la militante. On demande aux ingés cadres et techs d’innover, de créer de la valeur, tout en sabotant les conditions mêmes de leur travail à travers des diminution d’effectifs et de moyens. »
La mondialisation renforce le phénomène : « Aujourd’hui, les travailleuses et travailleurs du monde entier sont dans une situation d’interdépendance, massivement organisée par des logiques financières. C’est pourquoi l’Ugict, dans son document d’orientation, a identifié comme un enjeu la nécessaire internationalisation de notre action syndicale pour créer des coopérations professionnelles au service du progrès humain. »
« Le management actuel attaque le sentiment d’utilité sociale »
Autre indice de cette période de basculement : le pessimisme dans la population. Fabienne Rouchy, membre de la direction confédérale et siégeant pour la CGT au Conseil économique, social et environnemental (Cese), rappelle notamment un élément issu du tout récent rapport annuel sur l’état de la France, présenté par le Cese : « 74% de nos concitoyennes et concitoyens s’inquiètent énormément pour l’avenir, précise-t-elle. Cela a beaucoup augmenté depuis un an. »
La question du sens du travail, expression popularisée dans la période post-Covid, ne date pourtant pas d’hier. Coauteur, avec Coralie Perez, de l’ouvrage Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire (Seuil, 2022) Thomas Coutrot date cette prise de conscience du début des années 2010, suite à la crise financière de 2008. Dans ses enquêtes, il recueille régulièrement des témoignages de mal-être : « Mon travail a perdu son sens », « je n’en peux plus » sont des phrases récurrentes. Comment se traduit cette perte de sens ? « Le management actuel attaque le sentiment d’utilité sociale, le sentiment de bien faire son travail, et la capacité de s’épanouir. On a le sentiment que ce qu’on fait n’est pas utile, que cela va à l’encontre de notre éthique morale ou professionnelle », détaille l’économiste membre d’Attac.
« Constamment contrôlé via les process ou le reporting »
Des statistiques tirées de l’ouvrage de Thomas Coutrot en montrent les conséquences concrètes : la perte de sens au travail augmente de 30 % le taux de démission ; elle multiplie par deux le risque de tomber en dépression. Conclusion : « Au lieu de culpabiliser les médecins qui accordent des arrêts maladie, il vaudrait mieux se préoccuper de l’organisation du travail dans les entreprises. » Patrick Loire, consultant spécialisé dans les questions de santé et de conditions de travail au sein du cabinet Secafi, abonde : « Il y a un paradoxe entre le fait de fonctionner en “mode dégradé”, c’est-à-dire de devoir faire des choix, faute de moyens, et dans le même temps d’être constamment contrôlé via les process ou le reporting. »
Au-delà du constat, la table ronde a soulevé des pistes pour lutter contre cette perte de sens. Thomas Coutrot insiste sur la nécessité d’associer davantage les travailleuses et les travailleurs aux prises de décisions, et notamment aux changements organisationnels. « Quand un changement est imposé d’en haut sans aucune concertation, la santé mentale des salarié·es se détériore fortement, autant chez les ouvriers et employés que chez les cadres et ingénieurs, nous avons pu l’évaluer statistiquement. Mais lorsque qu’on leur demande leur avis, ils et elles vont mieux, poursuit le chercheur. Or, selon nos enquêtes, seul·es 15 % des salarié·es déclarent que leur avis a été pris en compte lors d’un changement organisationnel. C’est le nœud du problème. »
« Mener des enquêtes, élaborer avec les salarié·es »
Sur cette question, l’économiste estime que le syndicat a un rôle à jouer : « Il peut organiser lui-même l’expression des salarié·es et ne pas attendre que le patron le fasse. Il peut mener des enquêtes, élaborer avec les salarié·es des revendications très précises, liées à des situations spécifiques. Cela permet de gagner des batailles au sein de l’entreprise et de rapprocher les salarié·es des militantes et militants. » Le chercheur donne l’exemple de la SNCF où, entre 2015 et 2017, des militants et militants ont été formés à l’enquête auprès des salarié·es. « Résultat : des victoires ont été obtenues sur plusieurs sites, et la CGT y a gagné de nouveaux adhérents. »
La démocratie au travail serait donc l’antidote à la perte de sens ? C’est l’avis de Patrick Loire comme de Thomas Coutrot : « Les personnes qui en souffrent sont ouvertes et disponibles pour mener des actions, pour réfléchir à la manière de lutte contre ces mécanismes de domination. C’est un levier extrêmement puissant pour le mouvement syndical, s’il arrive à s’en saisir. »
Des « frustrations » autour des IRP
Christine Chiffre confirme cette exigence de démocratie sociale en citant le dernier baromètre de l’Ugict-CGT : 66 % des cadres disent ne pas être associés aux choix stratégiques de leur entreprise, 52 % assurent être fréquemment en désaccord avec les choix de leur entreprise. La militante de l’Ufict-Métallurgie ajoute : « Voila pourquoi une revendication importante du document d’orientation, c’est la nécessité de gagner de nouveaux droits pour permettre aux ingés cadres et techs de vivre un management qui s’appuie sur la responsabilité professionnelle. »
Lors du débat avec le public, la question du rôle des militantes et militants au sein des instances représentatives du personnel (IRP) est soulevée. Yvon Escribe, de l’UFCM des Cheminots met en doute la capacité des IRP à obtenir des victoires syndicales d’ampleur. Cette intervention est saluée par des applaudissements et des approbations. Fabienne Rouchy le concède : « Il peut y avoir des frustrations », mais elle rappelle l’importance d’y siéger pour assurer la représentativité de syndicats. Patrick Loire souligne également que suite à la vague de suicides chez France Télécom, entre 2006 et 2011, le procès a pu se tenir en 2019 grâce aux éléments consignés dans les IRP.