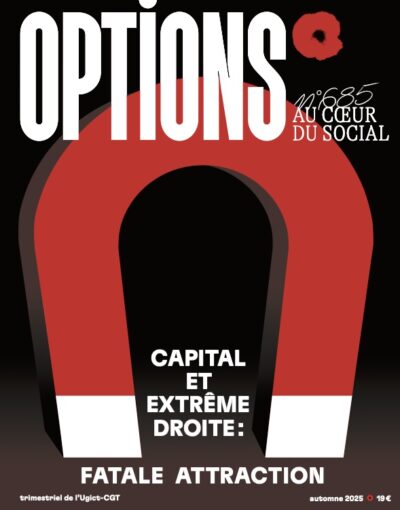« Les Ictam sont en première ligne dans les crises et dans les solutions, et ils portent une exigence sociale, écologique mais aussi de paix et de démocratie, expose Cyril Dallois, secrétaire national sortant de l’Ugict-CGT. Et avec notre travail et nos qualifications, nous pouvons organiser la riposte. La bataille des idées nécessite de passer du revendicatif au rapport de force. »
La première intervenante, Jasmine Ricciardi, a commencé à s’intéresser au syndicalisme en 2017 alors qu’elle travaillait à l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), qui salarie 1 300 personnes dont 79 % cadres et 15 % d’agentes et agents de maîtrise, les trois quarts étant des femmes. Elle constate alors qu’il n’y a qu’un seul manageur syndiqué à l’Ugict-CGT. Après avoir fait sa connaissance, elle s’engage pour les élections de 2018.
Création d’un syndicat à l’Apec
Avec seulement trois candidat·es, la CGT réunit 7 % des suffrages. Ce n’est pas suffisant pour être représentatif, mais Jasmine entre au comité économique et social et devient secrétaire adjointe de la commission égalité et diversité, puis crée un syndicat au sein de l’Apec. « Nous étions juste après #MeToo et j’étais étonnée qu’à l’Apec on ait aussi peu de remontées sur les violences sexistes et sexuelles (VSS), se remémore-t-elle. Alors je me suis dis qu’il fallait comprendre et aussi sûrement libérer la parole. »
Petit à petit le travail de déconstruction porte ses fruits et, aux élections de 2022, l’Ugict-CGT double son score avec 14 % des voix. Il est temps d’approfondir le travail sur la lutte contre les VSS et sur le temps de travail. Sur le premier volet, ce bon résultat et l’implication de la direction permettent d’aller plus loin dans les revendications. « Les 1 300 salarié·es ont participé à un webinaire obligatoire sur la lutte contre le sexisme, explique Jasmine. La direction des ressources humaines s’est impliquée dans une politique de tolérance zéro, et la culture de l’égalité est entrée à l’Apec. Avec les autres organisations syndicales, nous avons réussi à nous rassembler sur ce sujet et je suis devenue référente pour la lutte contre le harcèlement et les VSS. »
Une enquête, un rapport, de la visibilité
Au début de son premier mandat, Jasmine se désolait des « représentations négatives, voire caricaturales » de la CGT. « L’élection de Sophie Binet à la tête de la confédération en 2023 a aussi été un message fort aux cadres », juge-t-elle. Elle engage alors une réflexion sur le temps de travail. Avec Erwan Audren, doctorant en économie, elle adapte et déploie l’enquête de l’Ugict sur le sujet. Avec 250 réponses, cette enquête permet de rédiger un rapport de 10 pages et plusieurs tracts de synthèse, et donne ainsi de la visibilité au syndicat.
Après les 7 % recueillis en 2018 et les 14 % en 2022, l’Ugict-CGT de l’Apec vise carrément 28 % des voix aux élections de 2026. « Plutôt que d’embrigader les gens, nous sommes allé·es les chercher là où ils étaient, explique Jasmine. Par exemple, dans notre commission exécutive, nous avons mis des personnes qui n’étaient pas forcément conquises par l’Ugict. »
Simuler une vraie grille salariale
Le témoignage suivant est proposé par Christophe Innocent, membre de l’Ufict-CGT Mines-Énergies. Il travaille au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), un établissement public industriel et commercial fondé en 1959. « Jusqu’en 1996, explique-t-il, il y avait une grille salariale mais, avec l’accord de certains syndicats, notamment de la CFDT, elle a été abrogée et remplacée par l’avancement au mérite. À présent nos salaires sont inférieurs de 15 % par rapport aux autres Epic, et de 25 % par rapport au marché. » Plusieurs tentatives de rattrapage ont lieu, sans aboutir. « La grille des salaires, c’était devenu incantatoire », observe-t-il.
Aux élections de 2022, après soixante-trois ans de domination de la CFDT, la CGT récolte 36 % des votes, devenant le premier syndicat au BRGM. Durant deux ans, le syndicat travaille sur une proposition de grille inspirée de celle de la fonction publique. Des assemblées générales, des permanences et des tracts la font connaître. « On a une plateforme revendicative claire sur les salaires, poursuit Christophe. Cette grille n’appartient pas à la CGT ; il faut qu’elle devienne celle de nos collègues, sans elles et eux, on n’est rien. On propose aussi des simulations ce que seraient nos salaires si la grille de 1996 avait été maintenue, et nous expliquons que cela n’interdit pas les promotions individuelles. Nous sommes bien partis pour convaincre ! Cette grille est un outil simple et juste qui reconnaît les qualifications et l’expérience. » Optimiste, Christophe espère que la grille des salaires sera le principal enjeu des élections de 2026 au BRGM.
Des réglettes pour mesurer le temps de travail
Quand son tour vient, Yvan Escribe, membre de l’UFCM de la CGT Cheminots, expose l’intérêt de structurer le travail syndical en proximité pour mailler le territoire et ancrer les revendications. « La SNCF est une entreprise très hiérarchisée, presque militaire, décrit-il, mais c’est la force de l’entreprise, en particulier en matière de sécurité et de production. Sauf qu’on constate, dans tous les collèges, une perte de moyens, une perte de repères et de sens au travail. Nos revendications sont communes. Notre rôle est de faire prendre conscience aux travailleuses et aux travailleurs qu’ils sont tous des salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail. Un cadre qui en prend conscience peut s’organiser avec ses collègues des autres collèges. »
Après avoir illustré ses propos par diverses actions – réglettes pour mesurer le temps de travail, vidéos explicatives quand le syndicat se retire des instances – Yvan soulève l’enthousiasme de l’auditoire quand il souligne qu’à la SNCF, un cadre sur deux a voté CGT aux dernières élections.
En Île-de-France, 58 % des salarié·es sont des Ictam
Les vertus du travail collectif sont également rappelées par Édith Biechlé, membre de l’union régionale CGT Île-de-France. « Ce n’est pas un territoire comme les autres, décrit-elle. C’est le lieu du pouvoir et le berceau des inégalités. Il compte 1,5 million de cadres, et 58 % des salarié·es qui y travaillent sont des Ictam. »
Alors que les conditions économiques diffèrent fortement d’un département à l’autre, l’enjeu de l’union régionale de de faire travailler ensemble les union départementales en s’appuyant sur les données diffusées par la confédération et par l’Ugict, ainsi que sur les outils comme les tracts, les campagnes, les webinaires ou les formations. Aux dernières élections, les efforts de formation et de préparation des syndicats d’Alstom et du Muséum d’histoire naturelle ont été fructueux.
Syndiquer les micro-entrepreneurs
Quand la parole revient dans la salle, Christine Fourage, secrétaire générale du Syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés (SNPEFP-CGT) fait valoir que ce secteur, qui emploie « le lumpenproletariat des Ictam », recourt abusivement au micro-entreprenariat et aux CDD d’usage afin de contourner les obligations légales sur la représentation des salarié·es. Le SNPEFP a donc décidé de syndiquer ces micro-entrepreneuses et micro-entrepreneurs, et invite la CGT et l’Ugict à faire de même.
Le témoignage de Sophie Labrune, cadre à La Poste, fait résonner les applaudissements et les youyous. Depuis le confinement de 2020, la FAPT a mis en place une liste de diffusion pour joindre les cadres en télétravail. « Nous ne nous sommes pas préoccupé·es de savoir si nous avions le droit », élude-t-elle. Depuis, chaque mois, l’Ugict envoie un tract à 44 000 personnes : « Nous avons entre 10 et 20 % d’ouverture, et ça donne de la visibilité à la CGT. »
Quand, en octobre, la Poste passe un accord avec la plateforme chinoise de commerce Temu, le syndicat voit rouge. Et en fait le sujet de son tract, qui explose son audience habituelle : « En vingt-quatre heures, nous avons eu 75 % d’ouverture et même 80 % après le week-end », détaille Sophie. Étonnamment, la direction de la Poste se réveille alors, et proteste contre cette liste de diffusion qui, selon elle, ne respecte pas les règles de l’entreprise. Moralité : « Le syndicat de classe et de masse, ce n’est pas que les ouvriers, et ça les cadres l’ont bien compris ! »