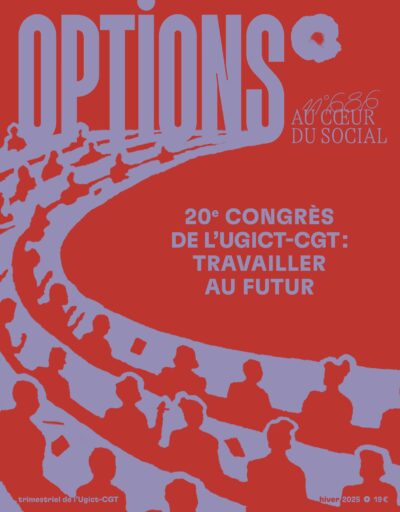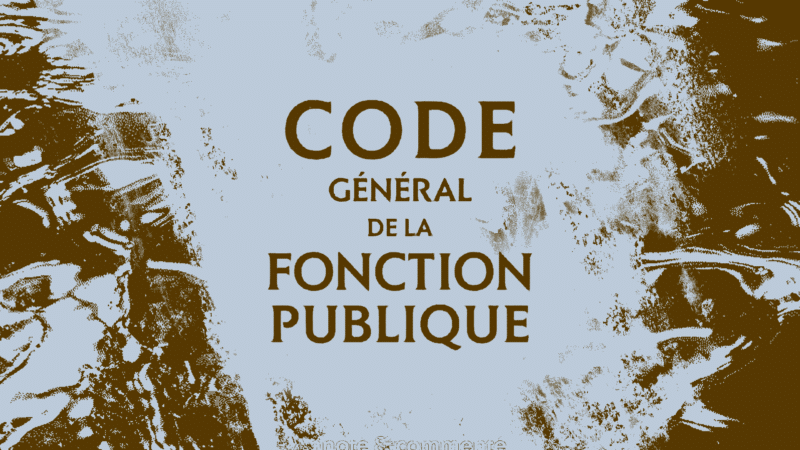Depuis les années 1980, un mantra domine les débats économiques en France : le « coût du travail » est trop élevé. Les gouvernements successifs s’appliquent à le réduire, via des exonérations de cotisations salariales ou patronales. Des mécanismes qui, au motif de « créer des emplois », pèsent aujourd’hui sur les finances publiques à hauteur de 75 milliards d’euros par an. Dans son essai Toujours Moins !, Clément Carbonnier, professeur d’économie à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, montre à quel point ils sont inefficaces et renforcent les inégalités.
Clément Carbonnier : Sur quels éléments vous appuyez-vous pour remettre en cause les politiques de réduction du « coût du travail » ?
J’ai dirigé l’équipe d’universitaires chargée d’un des rapports d’évaluation du crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)1, l’un des dispositifs les plus représentatifs des politiques d’exonérations de cotisations sur les salaires, instauré en 2013. Nous avons testé son impact sur l’emploi entre 2013 et 2015 en analysant des comptabilités d’entreprises analogues. En raison des effets de seuil (le crédit d’impôt est accordé pour les salaires jusqu’à 2,5 fois le Smic), certaines avaient touché plus d’aides que d’autres. Nous avons alors observé que les entreprises qui ont touché le plus de CICE n’ont pas créé ni sauvegardé davantage d’emploi que celles qui en ont peu bénéficié. À l’étranger, notamment dans les pays scandinaves où les cotisations sociales sont relativement importantes, les études statistiques tirent les mêmes conclusions à propos des mesures de réduction du coût du travail : pas de réel effet sur l’emploi ni sur l’investissement.
Pourtant, en France, le taux chômage est passé de 10,3 % à 7,5 % en dix ans. Cette réduction ne peut-elle pas être attribuée à des dispositifs de type CICE ?
En l’absence de ce dispositif, nous aurions probablement eu les mêmes créations d’emplois en raison du rebond économique après la crise de 2008. Car on a observé la même baisse du chômage dans les pays voisins, dont ceux qui avaient augmenté leur salaire minimum, comme l’Espagne. Si l’on considère que le « coût du travail » a un impact fort sur la quantité d’emplois, ces hausses auraient dû symétriquement engendrer des suppressions de postes. Or, ce n’est pas ce qui a été observé.
Vous affirmez également que la réduction du coût du travail a eu des effets inégalitaires. Lesquels ?
Quand on a commencé les premières exonérations de cotisations dans les années 1990, celles-ci devaient être compensées par l’État. Mais ce dernier se prive ainsi de moyens pour les services publics. L’État a donc resserré le budget de la Sécurité sociale, en réduisant par exemple les remboursements de soins. Or, quand on comprime la Sécurité sociale et qu’on affaiblit les services publics, c’est dommageable aux ménages les plus fragiles qui n’ont pas les moyens de s’offrir de la protection sociale privée.
N’y-a-t-il donc que des perdants dans cette politique ?
Non, il y a aussi des gagnants. Les exonérations de cotisations augmentent les marges des entreprises, ce qui profite à leurs actionnaires. Parmi les travailleurs les mieux rémunérés, on a aussi observé des augmentations de salaires. En fait, d’une certaine manière, c’est une politique de classe. Et les « gagnants » pèsent pour que cette politique d’exonération se poursuive, ni dans un but d’expansion économique, ni au bénéfice du plus grand nombre, simplement dans leur intérêt.
Mais comment est-on arrivé là ? Pourquoi s’obstine-t-on à attaquer le coût du travail depuis les années 1980 ?
Dans les années 1970, la crise économique a amenuisé les fruits de la croissance, d’où une tension sur leur partage, qui a conduit les employeurs à exiger des gouvernements une baisse du « coût du travail ». D’autant plus que l’inflation était forte – ce qui faisait craindre des effets d’emballement entre inflation et salaires – et qu’on ouvrait davantage l’économie à la concurrence internationale. Dans ce contexte, la compétitivité a aussi été fortement mise en avant – et plutôt sur les prix que sur la qualité des produits.
L’utilisation de l’expression « charges sociales » à la place de « cotisation sociales » n’est-t-elle pas révélatrice de cet état d’esprit ?
À la fin de l’année 1981, Yvon Gattaz se fait élire à la tête du Conseil national du patronat français (CNPF), l’ancêtre du Medef, en faisant campagne sur « la bataille des charges » : il faut baisser les coûts des entreprises pour que les profits « ruissellent ». C’est le moment où l’on met en avant ce côté « charges », qui signifie que les cotisations sont vues comme des dépenses et non comme des investissements. En 1982, à la suite d’une rencontre entre Yvon Gattaz et le Premier ministre, Pierre Mauroy, le gouvernement décide d’un moratoire sur les cotisations salariales : plus question de les augmenter pour répondre aux nouveaux besoins de protection sociale. On va donc réfléchir à d’autres modes de financement, ce qui in fine aboutira à la création de la contribution sociale généralisée (CSG) en 1991.
Ces politiques peuvent-elles être remises en cause aujourd’hui ?
Ça commence à être le cas : leur inefficacité est patente et il y a de plus en plus de débats à ce sujet. Les exonérations de cotisations commencent à être questionnées par des groupes à l’Assemblée nationale. Michel Barnier, dans son budget finalement censuré en décembre 2024, avait montré une légère inflexion en proposant de lever un peu les exonérations de cotisations au niveau du salaire minimum. Le mouvement a commencé, mais il y a encore des résistances. Il faut en faire un débat public pour forcer les décideurs à mettre sur la table cette question-là.
Mais alors, quels leviers peut-on activer pour combiner compétitivité économique et finances publiques équilibrées ?
D’abord, prenons le cas des entreprises qui ne sont pas exposées à la concurrence internationale. De quoi ont-elles besoin ? D’une main d’œuvre en bonne santé, bien formée, et qui peut exprimer ses compétences dans de bonnes conditions de travail. Il faut donc renforcer la formation et l’éducation. Leurs effets n’interviennent qu’à long terme, mais ils sont importants. Ensuite, pour ces entreprises qui vendent principalement en France, la question est celle de la demande locale, donc du niveau de vie des Français. Pour leur rendre du pouvoir d’achat, il faut défendre le salaire net, mais également le brut, car tout un pan de la consommation est fourni par la protection sociale et les services publics.
Et pour les entreprises soumises à la concurrence internationale ?
On ne va pas concurrencer le Vietnam ou la République tchèque en termes de coût du travail. Si on veut avoir notre place sur les marchés internationaux, cela passe par une meilleure qualité de la production. Cela nécessite d’investir dans l’innovation. Ensuite, les entreprises privées vont utiliser ces travaux et les développer. Les grandes innovations de ces dernières années, notamment aux États-Unis, sont majoritairement liées à des financements publics au départ. Et ensuite, quand l’innovation existe, les entreprises se lancent.
- Clément Carbonnier, Toujours moins ! L’obsession du coût du travail ou l’impasse stratégique du capitalisme français, La Découverte, 2025, 184 pages, 20 euros.
- Rapport du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques (Liepp) de Sciences Po en réponse à l’appel à évaluation de France Stratégie, 31 août 2018.