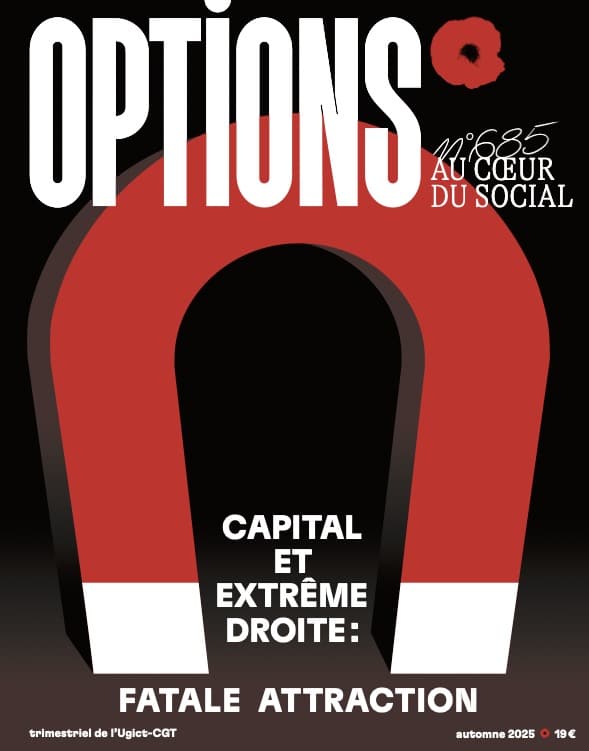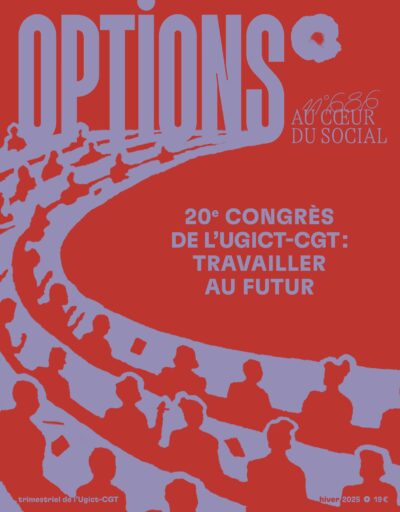C’était il y a trente ans ! Plus de trois semaines d’assemblées générales quotidiennes sur les lieux de travail, tout particulièrement chez les cheminots ou à la RATP, suivies de grèves reconductibles dans les transports, d’actions dans bien d’autres secteurs — éducation nationale et université, services publics, énergie, postes et télécoms, dans certaines entreprises du privé, sans oublier les manifestations locales et nationales d’ampleur plusieurs fois par semaine.
D’abord présentée comme corporatiste et indéfendable dans les médias, cette mobilisation est pourtant rapidement plébiscitée par la grande majorité des Français, au point qu’on parlera de « grève par procuration » : ceux qui ne peuvent pas faire grève ou manifester contribuent massivement aux caisses de soutien, et ne rechignent pas à marcher des heures ou à s’entraider pour aller travailler. « Nous ne sommes pas pour rien dans l’avènement du co-voiturage », plaisante Bernard Thibault, un des principaux protagonistes de ces semaines d’ébullition sociale, alors secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, et figure emblématique de ce que l’histoire appellera d’emblée le « mouvement social de novembre-décembre 1995 ».
Bernard Thibault, qui deviendra secrétaire général de la CGT de 1999 à 2013, était un des acteurs de l’événement, invité mi-octobre par l’Institut d’histoire sociale CGT à en raconter les coulisses. Il avoue dans la foulée qu’avoir été catapulté sous les feux de l’actualité, et quasi starisé du fait de ses faux airs de Jacques Dutronc et, surtout, de sa capacité à argumenter sans jamais perdre son sang froid « a un peu bouleversé le cours de (sa) vie » !
La retraite et la Sécu, déjà dans le collimateur
Rembobinons pour celles et ceux qui n’ont pas vécu cette période, dont il est encore difficile d’évaluer la place qu’elle prendra dans la mémoire collective, même si déjà, pour l’histoire, c’est la plus importante mobilisation sociale depuis 1936 et 1968. À l’automne 1995, Jacques Chirac, élu président de la République, notamment sur sa promesse de réduire la « fracture sociale », confie pourtant à son Premier ministre, Alain Juppé, la mission de s’attaquer aux régimes de retraite des fonctionnaires et des services publics (Edf, SNCF, RATP) en les alignant sur la réforme Balladur de 1993, qui a imposé le temps de cotisation à 40 annuités dans le privé pour une retraite à taux plein. « Le plan Juppé est présenté le 15 novembre et s’accompagne d’un plan de réforme de la Sécurité sociale, qui prévoit notamment d’augmenter le forfait hospitalier, de dérembourser ou moins rembourser certains médicaments, de créer un nouvel impôt, la CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) et de déposséder les partenaires sociaux de la gestion de l’assurance maladie, l’État prenant la main avec la création du PLFSS (Projet de loi de financement de la Sécurité sociale), récapitule Rémi Azemar, historien, dont la thèse de doctorat (en 2024) porte sur le mouvement. Le climat général est à la colère et de nombreuses actions ponctuelles ont lieu pendant l’année, d’autant que le gouvernement a déjà annoncé sa volonté de restructurer les services publics en opérant des externalisations et autres filialisations pour rendre possibles d’éventuelles privatisations, et impose l’austérité, en commençant par geler les salaires des fonctionnaires, contre l’avis de près de 80 % des Français d’après un sondage Sofres de l’époque. Le 10 octobre, une grève des fonctionnaires, tous secteurs confondus, en réponse à un appel intersyndical unitaire — du jamais vu depuis vingt ans —, est massivement suivie. »

« Le contrat de plan de la SNCF doit pour sa part être validé fin décembre, et nous en connaissons déjà le contenu, poursuit Bernard Thibault. Un tiers des lignes (soit 6 000 km), jugé non rentable, va être supprimé, les prix des billets augmentés (de 6 %), avec les conséquences qu’on imagine sur nos effectifs (des milliers de postes sont menacés) et sur la qualité du service rendu aux usagers. Les cheminots ont déjà participé aux mobilisations de fonctionnaires d’octobre, et à la fédération CGT, nous nous interrogeons sur les formes et les suites à donner à d’éventuelles actions. Nous sommes en plein Conseil fédéral quand nous apprenons que le Plan Juppé va supprimer notre régime de retraite, ce qui signifie au minimum deux ans et demi de travail en plus, y compris pour les roulants, pour ceux qui travaillent de nuit et pour tous nous collègues soumis à un travail pénible. Comme le dira un cheminot cherchant une image juste : c’est la goutte d’eau qui met le feu aux poudres ! » Les cheminots décident de se joindre à un nouvel appel à manifester, le vendredi 24 novembre. « Durant le week-end, ceux qui travaillent organisent des assemblées générales sur le terrain et appellent à la grève reconductible. On comprend alors que la mobilisation peut durer. »
Un slogan d’avenir s’impose : « Tous ensemble, tous ensemble ! »
Et elle durera, menée par des cheminots rôdés depuis des années à la pratique du débat, y compris hors de l’entreprise, qui ont intégré les enjeux et les arguments liés à l’avenir de la SNCF, et sont capables de les expliquer à n’importe quel contradicteur. La CGT mise sur le rassemblement et installe naturellement son leadership, y compris parmi les cheminots dont le syndicat, au national, choisit de ne pas soutenir la grève — à l’issue du conflit, les cheminots CFDT feront sécession et rejoindront la CGT ou Sud. « Le tout TGV, nous n’étions pas contre, poursuit-il, mais pas au prix du sacrifice du réseau, et sans en discuter avec les usagers ou les élus locaux. Nous avons produit une carte de France sans les liaisons qui devaient être supprimées, ça a créé un électrochoc sur tout le territoire ! »
« La mobilisation prend, partout et sous de multiples formes, détaille Rémy Azemar, qui a particulièrement documenté les petits territoires, où la CGT n’est pas toujours présente, mais où les services publics sont souvent le principal employeur et les garants du lien social. Partout, la démocratie de terrain se déploie, les débats s’ouvrent à tous et débordent du cadre revendicatif de départ, déclinant de nombreuses aspirations sociales, dans une ambiance plutôt joyeuse. Le patronat tente des contre-manifestations, elles font flop. En revanche, nombreux sont les commerçants ou les petits patrons qui aident les grévistes, par exemple en leur fournissant de la nourriture. »
« On s’en souvient moins, mais les lycéens, les étudiants et les enseignants sont très nombreux à se mobiliser » souligne Michel Deschamps, premier secrétaire général de la jeune FSU (de 1993 à 1999), fruit de la scission de la puissante FEN trois ans plus tôt, et qui rassemble les syndicats les plus combattifs des personnels de l’Éducation nationale. « Nous nous inscrivons pleinement dans la démarche de syndicalisme rassemblé impulsée par le secrétaire général de la CGT, Louis Viannet. Les mobilisations de l’automne sont exceptionnelles, avec par exemple 70 % de grévistes dans le primaire, et celles qui suivront à la fin de l’année compteront parfois un tiers des manifestants fonctionnaires de l’Éducation nationale. ».
Un mouvement initié et dirigé de bout en bout par les syndicats
Au bout de trois semaines de paralysie de l’économie, au moins 6 millions d’heures de grève (d’après une étude de la Dares) et des millions de manifestants, le Premier ministre reste « droit dans ses bottes », mais le président Chirac tranche et le plan Juppé sur les retraites est supprimé le 15 décembre, un mois après son annonce. Victoire totale sur ce point, c’est le ressenti sur le moment : même éphémère, ce recul permettra à toute une génération de partir après 37,5 ans de travail. Le plan de réforme de la Sécurité sociale sera en revanche adopté via un train d’ordonnances… « Certains auraient aurait voulu que nous poursuivions la mobilisation, mais les fêtes de fin d’année approchaient et la grève commençait à peser sur nos revenus, intervient Maryse Dumas, secrétaire confédérale et dirigeante de la fédération des activités postales et de télécommunication CGT à l’époque. À la Poste, les retenues sur salaires ont duré deux ans ».
Pour l’IHS, et pour les militants, il ne s’agit pas simplement de se remémorer ces événements, mais de les analyser pour peut-être en tirer des enseignements sur ce qui a permis à la mobilisation de prendre, et de faire référence. En 1995, le syndicalisme n’est pas au mieux de sa forme, la désindustrialisation et l’affaiblissement des utopies révolutionnaires aidant. Ce mouvement trouve sa force et son succès dans un recentrage sur le revendicatif, dans la place donnée au terrain et le souci de l’unité. Une sorte de retour aux sources, qui va illustrer avec éclat la place incontournable du syndicalisme comme ciment social, sa pertinence et sa légitimité à défendre l’intérêt général, et prouver que la force collective et organisée peut peser face à l’injustice sociale… « Il faut se donner les moyens de ses objectifs, et ce fut le cas confirme Bernard Thibault, nous avions un outil syndical tout à fait efficace et réactif, alors que nous n’avions que des fax et des téléphones, dont quelques-uns portables ! »
Une seule méthode : démocratie et rassemblement unitaire
« Ce mouvement ne vient pas de nulle part, insiste-t-il, c’est aussi le résultat d’une prise de conscience de ce qui nous a fait rater les mobilisations de 1986-1987 à la SNCF. À l’époque, nous avons été débordés par les coordinations qui se développaient aussi ailleurs contre les syndicats (dans la santé aussi, par exemple), se montrant très actives ponctuellement, mais corporatistes et limitées dans leur volonté de rassemblement et dans leur efficacité, faute de convaincre sur leurs motivations. La CGT à elle seule était pourtant majoritaire à la SNCF. Nous avons dès lors multiplié les débats et l’écoute de tous nos collègues sur le terrain, toutes catégories et métiers confondus, et favorisé les convergences ».
Le mouvement a eu une résonance au-delà des frontières, notamment au travers du 45e congrès de la CGT, qui s’est ouvert à Montreuil en pleine mobilisation, en présence de 130 délégations internationales. Il a donné une bouffée d’oxygène au syndicalisme — Bernard Thibault raconte qu’une femme a versé à la caisse de grève le remboursement sécu de ses derniers frais médicaux avec ce message : « c’est à vous que je le dois ». En reste aussi l’idée que la lutte peut parfois gagner, que le droit de grève et de manifester sont précieux et doivent être défendus, y compris par nos élus, même si le dogme actuel est plutôt à la répression. En reste aussi de la fierté. Le mouvement a été soutenu par des intellectuels, dont la figure la plus marquante de l’époque, le sociologue Pierre Bourdieu, accueilli le 12 décembre dans les locaux de la gare de Lyon, où il prononce un discours devant des centaines de cheminots euphoriques, qui sera développé dans la presse sous forme de tribune : « Je suis ici pour dire notre soutien à tous ceux qui luttent depuis trois semaines contre la destruction d’une “civilisation” associée à l’existence du service public, celle de l’égalité des droits, droits à l’éducation, à la santé, à la culture, à la recherche, à l’art, et par-dessus tout, au travail. Je suis ici pour dire que nous comprenons ce mouvement profond, c’est-à-dire à la fois le désespoir et les espoirs qui s’y expriment (…) Emplies de ses “certitudes technocratiques”, la “noblesse d’État” “ne comprend pas que le peuple, au nom duquel (elle prétend) gouverner, descende dans la rue pour s’opposer à (elle)”. (…) Ce qui est en jeu, c’est la reconquête de la démocratie contre la technocratie », la défense du bien public, de la chose publique, de la République. »