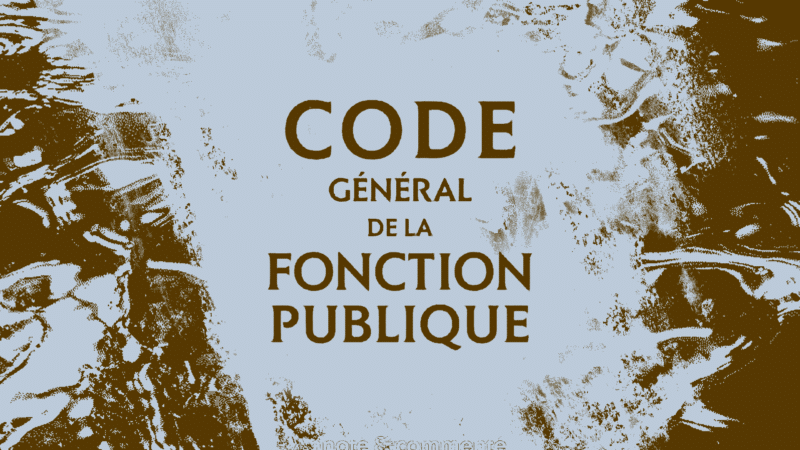Lorsque l’état de santé d’un salarié se dégrade pendant une période de congés payés, il peut, au regard de son état de santé, bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie ou pour accident. Ces journées en arrêt maladie ne sont plus à décompter des jours de congés payés et seront reportées ultérieurement après le retour dans l’entreprise. Cette règle est applicable grâce à la jurisprudence européenne depuis 2009. La Commission européenne exige de la France la modification de sa législation pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.
Jurisprudence en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident pendant les congés payés
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne de Luxembourg, « la finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail ».
Par conséquent, « un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie » (Cjue 10 septembre 2009, Francisco Vicente Pereda contre Madrid Movilidad SA, spéc. § 22).
En effet, la directive européenne n° 2003/88/CE « s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail. » (Cjue 21 juin 2012, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución [Anged] vs Federación de Asociaciones Sindicales (Fasga), Federaciόn de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federaciόn Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de Ugt, Federaciόn de Comercio, Hostelería y Turismo de Ccoo, spéc. § 20 et suivants).
Ainsi, selon la jurisprudence européenne, « le travailleur a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue. »
Le salarié devra bénéficier du report des jours de congés payés dont il n’a pu bénéficier du fait de son état de santé. Il bénéficiera du report des jours de congés payés coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.
Certaines juridictions nationales mettent déjà en œuvre la jurisprudence européenne.
Ainsi, il a été jugé que le salarié qui a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie au cours d’une période de congés payés, doit bénéficier du report des jours de congés correspondant aux jours d’arrêt de travail pour maladie : « durant ses congés payés, le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, il peut prétendre au report des jours d’arrêt maladie qui ne peuvent être imputés sur son solde de congés payés », « la maladie en cours de congé annuel suspend le cours du congé de sorte que le salarié peut prétendre au reliquat de congé » (cour d’appel Versailles, 18 mai 2022, Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion de la ville de Nanterre Semna, Rg n° 19/03230).
Des conventions collectives prévoient le droit au report des jours de congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail pour maladie ou accident (exemples : Ccn Missions locales et Paio, art. 5. 4. 3. Congés payés et arrêts maladie ; Ccn Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).
L’employeur devra informer le salarié sur les modalités de report des congés payés dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt maladie survenu au cours de sa période de congés payés.
« Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
- le nombre de jours de congé dont il dispose ;
- la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. » (Code du travail, art. L. 3141-19-3 nouveau).
Ainsi, au regard du droit de l’UE et notamment de la jurisprudence de la Cjue (supra), qui a primauté sur le droit national, la jurisprudence nationale ancienne selon laquelle « le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard » (Soc. 4 déc. 1996, 93-44.907) n’est plus applicable (cette jurisprudence nationale ancienne n’est plus de droit positif).
La Commission européenne a décidé d’ouvrir une procédure d’infraction en envoyant, le 18 juin 2025, une « lettre de mise en demeure » à la France [INFR(2025)4012] pour manquement aux règles de l’UE sur le temps de travail (directive 2003/88/CE).
La Commission estime que la législation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congé annuel puissent récupérer ultérieurement les jours de congé annuel qui ont coïncidé avec leur maladie.
La Commission considère que la législation française n’est donc pas conforme à la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santé et la sécurité des travailleurs. D’où cette mise en demeure. L’État français dispose d’un délai de deux mois pour y répondre et remédier aux manquements relevés par la Commission.
En l’absence de réponse satisfaisante, la Commission pourra décider d’émettre un « avis motivé ». Et en l’absence de modification satisfaisante du Code du travail, la Commission pourra saisir la Cjue à l’encontre de la France pour manquement.
Ces dispositions (jurisprudence européenne, lettre de mise en demeure de la Commission) sont pleinement applicables dans la fonction publique.
- Pour connaître ce droit, le comprendre et le mobiliser : Michel Miné, Le Grand Livre du droit du travail, Eyrolles, 31e édition, 2021, 848 pages.