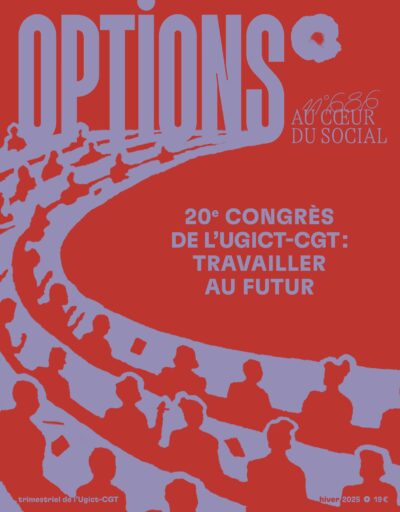Le 23 avril 2013, près de Dacca, au Bangladesh, l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza, faisait environ 1 138 morts et plus de 2 000 blessé·es, en grande majorité des ouvrières employées à la confection de vêtements pour les grandes marques occidentales.
Cette affaire mettait en évidence l’impunité des entreprises transnationales donneuses d’ordre concernant les conditions du travail chez leurs sous-traitants.
Pour y mettre fin, responsabiliser juridiquement les entreprises et garantir aux travailleuses et travailleurs des conditions de travail dignes, le « devoir de vigilance » a été inscrit dans la législation nationale. Il s’agit de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (Code du commerce, articles L. 225-102-1 et L. 225-102-2).
L’obligation légale de mise en œuvre d’un plan de vigilance
Selon cette loi, toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes, et dont le siège social est en France, ou au moins 10 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes, et dont le siège social est fixé en France ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent ces seuils sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.
Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers
- les droits humains et les libertés fondamentales ;
- la santé et la sécurité des personnes ;
- l’environnement.
Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.
Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale.
Il comprend les mesures suivantes :
- une cartographie des risques destinée à leur identification, à leur analyse et à leur hiérarchisation ;
- des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
- des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
- un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
- un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion.
La possibilité d’engager une action en injonction
Lorsqu’une société ne respecte pas ses obligations légales dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre de les respecter, le cas échéant sous astreinte. Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
La possibilité d’engager une action en réparation
Le manquement aux obligations légales engage la responsabilité de l’entreprise donneuse d’ordre, et l’oblige à réparer le préjudice causé, dans les conditions prévues par le Code civil, au titre des articles 1240 (« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ») et 1241 (« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »).
L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir à cette fin.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte.
La jurisprudence La Poste (cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 12, 17 juin 2025)
La SA La Poste forme avec ses filiales le groupe La Poste, qui comprend 232 700 collaborateurs, dont 22,7 % à l’international. En 2024, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 34,6 milliards d’euros. Cette société relève du champ d’application de la loi.
Considérant que la société La Poste ne respectait pas ses obligations de vigilance, la fédération Sud-PTT a, après mise en demeure, engagé une procédure judiciaire le 17 mai 2021.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la Poste aux entiers dépens et à payer au syndicat une somme de 5 000 euros. Il l’a également enjoint :
- de compléter le plan de vigilance par une cartographie des risques destinée à leur identification, à leur analyse et à leur hiérarchisation ;
- d’établir des procédures d’évaluation des sous-traitants en fonction des risques précis identifiés par la cartographie des risques ;
- de compléter son plan de vigilance par un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements après avoir procédé à une concertation des organisations syndicales représentatives ;
- de publier un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance.
La SA La Poste a fait appel de cette décision le 8 mars 2024. Parmi les avocats de la société figurait M. Bernard Cazeneuve, avocat d’affaires, ancien Premier ministre et à ce titre signataire de la loi du 27 mars 2017. Mais la cour d’appel a confirmé l’ensemble des injonctions ordonnées par le tribunal.
Sur la cartographie des risques
Pour la cour d’appel :
« la finalité des mesures contenues dans le plan de vigilance est double puisqu’elles doivent permettre d’identifier les risques liés aux activités des sociétés concernées, comprenant les sous-traitants et les fournisseurs, mais également de prévenir les atteintes graves dans les trois domaines concernés par le devoir de vigilance » ;
« la cartographie des risques au premier rang des mesures à prévoir dans le plan de vigilance d’une entreprise, puisque de celle-ci dépend la détermination des actions à mener pour réduire les risques, prévenir les atteintes graves et mettre en œuvre leur suivi » ;
« les risques à identifier et à évaluer dans le cadre de cette cartographie sont les risques réels et potentiels impliqués par les activités des sociétés concernées que les entreprises doivent prendre en compte pour cartographier leurs activités, afin de recenser les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves, puis procéder, sur la base de cette cartographie, à une évaluation approfondie de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et de leurs éventuels partenaires commerciaux, dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves ».
La cour relève au sujet de la cartographie des risques dans le plan de la société :
« tant pour les activités du groupe en France et à l’international (1), que pour celles des fournisseurs, prestataires et sous-traitants (2), les risques sont énumérés et décrits en des termes généraux dans chacune des trois catégories visées par L.225-102-4 I (droits humains et libertés fondamentales, santé et sécurité au travail, environnement), sans précision sur leur degré de gravité et des facteurs de risque pertinents qui ont permis de les retenir, de sorte qu’il n’en ressort aucune hiérarchisation comme l’exige l’article L.225-102-4 I, 1° du Code du commerce » ;
« la cartographie ne fait pas état d’une analyse des risques, mais de leur évolution globale qui est ainsi exposée de façon succincte » ;
« A plusieurs reprises il est ainsi question de risques maîtrisés, sans aucune précision sur leur degré de gravité » ;
« En conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’étape initiale de cartographie des risques du plan de de vigilance 2021 n’était pas conforme aux exigences … du code de commerce et ont fait droit à la demande d’injonction de la fédération Sud Ptt tendant à compléter le plan de vigilance par une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ».
Sur les procédures d’évaluation des sous-traitants en fonction des risques identifiés
Pour la cour d’appel,
« si La Poste décrit dans son plan de vigilance un mécanisme de contrôle de ses fournisseurs et sous-traitants en trois phases consistant en un questionnaire à remplir par ceux-ci, un audit documentaire réalisé à distance par un expert évaluateur de l’Afnor, puis des audits sur site, il n’en demeure pas moins que cette procédure d’évaluation ne peut être considérée comme conforme aux dispositions précédemment rappelées à défaut d’identification, d’analyse et de hiérarchisation des risques les plus graves dans la cartographie des risques du plan de vigilance 2021. » (illustrations : aucune précision sur le risque particulier lié aux infractions au code de la sécurité routière ; le risque lié au travail illégal n’est pas identifié alors qu’il résulte des éléments de procédure que ce risque est prégnant).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a enjoint à la société La Poste d’établir des procédure d’évaluation des sous-traitants précis et identifiés par la cartographie des risques.
Sur la concertation avec les organisations syndicales dans le cadre du mécanisme d’alerte »
Pour la cour d’appel,
« l’élaboration en concertation, diffère d’une simple consultation sur un projet prédéfini, et suppose une transmission d’éléments d’information et un échange de points de vue et de propositions sur la rédaction du contenu et la mise en œuvre du mécanisme à établir, en vue, et donc en amont, de son élaboration.
La société La Poste ne démontrant pas avoir mis en place un dialogue avec les organisations syndicales préalablement à l’élaboration du mécanisme d’alerte et de recueil des signalements, le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint à La Poste de compléter son plan de vigilance par un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements après avoir procédé à une concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ».
Sur la publication d’un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance
Pour la cour d’appel,
« si la loi ne donne aucune précision quant à la forme du compte rendu de la mise en œuvre effective du plan de vigilance, il n’en demeure pas moins que son contenu doit être le reflet de ce qui est attendu du plan de vigilance et en lien étroit avec les mesures du plan qui le précédent ».
La cour relève dans le document produit par la société :
« le chapitre IX du plan de vigilance 2021 fait essentiellement état d’indicateurs choisis par la société La Poste qui révèlent une évolution dans certains domaines (égalité homme/femme, absentéisme maladie, accident du travail etc…) , mais ne donne aucune explication sur la mise en œuvre et les effets des mesures de vigilance prévues par le plan propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, alors que ces sujets sont au centre du devoir de vigilance des entreprises. Il ne peut donc être considéré que ce compte-rendu porte sur la mise en œuvre effective du plan » ;
« c’est en conséquence à juste titre que le tribunal a jugé que ce compte-rendu ne permettait pas de servir de bilan utile pour orienter l’action en matière de vigilance et qu’il y avait lieu d’enjoindre à La Poste de publier un réel dispositif de suivi des mesures de vigilance. Le jugement sera confirmé de ce chef également ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles
« Eu égard à la solution donnée au litige le jugement sera confirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile, La Poste étant en outre condamnée à payer à la fédération Sud-PTT une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. »
Cette jurisprudence, avec l’arrêt de la cour d’appel confirmant et précisant la motivation et la décision du tribunal, confirme l’importance du devoir de vigilance, véritable obligation légale imposant aux entreprises, avec l’ensemble de leurs parties prenantes, d’établir et de mettre en œuvre des plans de vigilance avec des contenus substantiels pour assurer chez les sous-traitants des conditions de travail assurant le respect des droits humains, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes.
Cette jurisprudence est importante à l’heure où les pouvoirs publics, en France et dans certains autres pays européens, tentent de réduire le contenu de la directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, dite directive CS3D).
Bibliographie : Michel Miné, Le Grand livre du droit du travail, Eyrolles, 32e édition, septembre 2025.