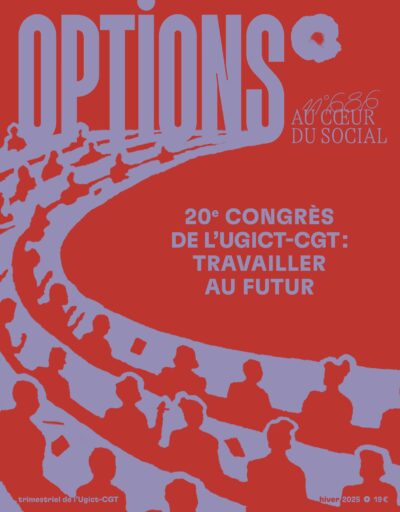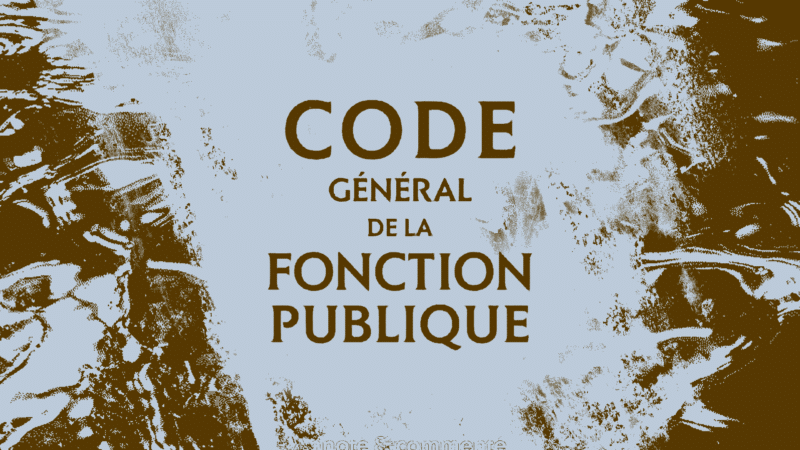« Il n’y a eu ni rupture ni engagement concret » : à l’issue de la rencontre de l’intersyndicale avec le nouveau Premier ministre, c’est ainsi que Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a résumé la teneur d’une discussion qui s’est finalement soldée par un « rendez-vous manqué ». Les deux heures et demie qu’a duré cet exercice rhétorique, avec la présence pour le moins déplacée de trois ministres démissionnaires (Fonction publique, Travail et emploi, Santé et solidarité), n’ont en effet apporté aucune réponse aux exigences formulées par l’intersyndicale quelques jours plus tôt.
Déjà, le gouvernement a déjà dû abandonner son projet de supprimer deux jours fériés et suspendu les décrets de doublement des franchises médicales. Mais ce qui est attendu, c’est qu’il renonce à l’ensemble de son projet de budget : année blanche, suppression de fonctionnaires… Pas un mot sur les services publics, les mesures de justice fiscale, la conditionnalité environnementale et sociale des aides publiques aux entreprises (211 milliards d’euros par an) ou l’abandon de la réforme des retraites. Tout juste Sébastien Lecornu a-t-il évoqué l’éventualité de ne pas procéder à une nouvelle réforme de l’assurance chômage, la dernière étant entrée en vigueur en avril 2025. C’est peu dire qu’il s’est montré sourd aux colères sociales qui se sont exprimées les 10 et 18 septembre. Démonstration quelques jours plus tard, lorsque il annonce, dans un entretien au Parisien, rejeter la taxe Zucman, le retour de l’ISF et toute
« révision » de la réforme des retraites.
Imposer d’autres choix budgétaires
Dans l’unité, les syndicats se sont insurgés, dans une déclaration publique : « Le monde du travail a assez souffert et c’est pourquoi l’ensemble des organisations syndicales appellent à amplifier la mobilisation » lors d’une nouvelle journée de manifestations et de grèves interprofessionnelles, le jeudi 2 octobre. « Nous sommes extrêmement en colère », a réagi Sophie Binet en rappelant qu’un million de personnes avaient manifesté ou fait grève, partout en France, le 18 septembre pour imposer d’autres choix budgétaires et faire entendre leur soif de justice sociale et fiscale.
Cette première journée de mobilisations à l’appel de l’intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires et FSU) avait été précédée du mouvement citoyen « Bloquons tout », dont l’ampleur et la forme étaient au départ incertaines. Mais ce 10 septembre avait enregistré un premier succès : 250 000 participants, selon la CGT, qui avait appelé à la mobilisation et recensé 1 000 appels issus de ses organisations. Dans le même temps, 80 000 gendarmes et policiers avaient été déployés sur tout le territoire pour « encadrer » quelque 100 000 « bloqueuses et bloqueurs » attendus par le gouvernement, sous la surveillance étroite de drones autorisés par 82 arrêtés préfectoraux.
✒︎ Dix ans d’état d’urgence : quand l’exception fixe la règle
L’acte II, le 18 septembre, a été marqué par une mobilisation massive dans de nombreux secteurs, notamment celui des transports. À la RATP, où l’appel à la grève était lancé par les quatre organisations syndicales représentatives (CGT, FO, Unsa et CFE-CGC), 10 000 grévistes ont été recensé·es. Partout, dans de nombreuses villes, quelle que soit leur taille, des manifestations importantes ont été organisées : 120 000 personnes rassemblées dans les rues de Marseille, 5 000 à Tarbes, 25 000 à Nantes… À Draguignan, dans le Var, les manifestantes et manifestants ont symboliquement déposé un chèque de 211 milliards d’euros devant le siège du Medef local. C’est, indique alors la CGT, la plus forte mobilisation sociale depuis le mouvement contre la réforme des retraites, en 2023. Qu’il faut désormais amplifier.