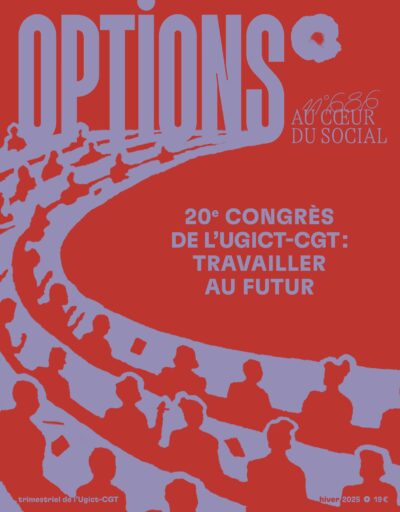Sur le chemin de l’égalité salariale, les progrès sont lents, trop lents. À tel point, mettent en évidence les données Eurostat (2024) que les femmes dans l’Union européenne gagnent encore, en moyenne, 12,7 % de moins par heure que les hommes. « Elles doivent donc travailler un mois et demi de plus qu’eux pour gagner autant », souligne Barbara Helfferich, co-autrice d’un rapport pour Eurocadres sur la mise en œuvre de l’égalité pour les cadres et les managers. En France, a montré une récente étude de l’Apec (Association pour l’emploi des cadres) sur la carrière des femmes cadres, l’écart est de 7 % à postes et profils identiques : « Il n’a pas bougé depuis dix ans », note Hélène Garner, directrice des données et des études.
Or, une grande partie (2/3) des écarts documentés apparaît « inexplicable et inexpliqué » : elle ne provient pas de caractéristiques objectives, comme le niveau d’études, la profession, le temps de travail ou le secteur d’activité. Adoptée en mai 2023, la directive européenne relative à la transparence salariale veut s’attaquer à cette anomalie et y mettre fin, en levant le secret, dans le public comme dans le privé. Pour aboutir in fine à des grilles salariales exemptes de biais : potentiellement, « elle est ainsi un instrument puissant pour documenter et mesure l’ampleur des discriminations et viser l’égalité », affirment unanimement les congressistes d’Eurocadres, lors d’un échange tirant les enseignements du projet « Assurer l’égalité : mettre en œuvre la transparence salariale pour les cadres ». Après l’organisation de deux ateliers, à Malte et en Hongrie, ce projet s’est notamment concrétisé par la publication d’un guide pratique à destination des syndicats*.
Transparence des rémunérations : dès l’embauche
Dans l’étude de l’Apec, le principe imposé par la directive est plébiscité : 66 % des cadres — et 75 % des femmes-y demandent une transparence des grilles de rémunération, par métier. Mais le temps, désormais, presse : c’est le 7 juin 2026 que les États devront avoir transposé la législation européenne qui garantit une protection minimale au sein des 27 États de l’UE, élargie à toutes les formes de discriminations. La transparence des rémunérations, qui concerne également les apprentis, les stagiaires ou les travailleurs de plateforme, devra alors être mise en œuvre dès l’embauche, avec des offres d’emploi mentionnant des fourchettes de salaires.
Les employeurs auront ensuite l’obligation de rédiger un rapport sur les écarts salariaux, selon un calendrier et une fréquence qui dépendent de la taille des entreprises : tous les ans, dès juin 2027, pour celles d’au moins 250 salariés ; tous les trois ans, également dès juin 2027, pour les entreprises de 150 à 249 salariés ; tous les trois ans, mais en juin 2031 pour celles comprises entre 100 et 149 salariés. Si ce rapport révèle un écart de 5 % ou plus, sans que l’entreprise ou l’administration soit en mesure de l’expliquer par des facteurs objectifs et neutres du point de vue du genre, une évaluation salariale devra être effectuée en collaboration avec les représentants du personnel. Placés sous la menace de sanctions « effectives, proportionnées et effectives », ce sont les employeurs qui devront prouver, devant les tribunaux, l’absence de discrimination.
Un écart de 23 % entre les femmes et les hommes managers
Ce n’est pas la première fois que l’Union européenne s’empare du sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes. Mais elle le fait aujourd’hui en s’attaquant à un tabou -le secret de la rémunération – et en adoptant une législation contraignante. Partout, l’objectif de transparence fait donc l’objet d’une forte hostilité patronale pour en limiter l’impact sur les structures salariales, au prétexte de la sauvegarde de la compétitivité et de la nécessaire « simplification ». La Finlande, où les femmes peuvent être élues au Parlement depuis 1906, n’échappe pas à cette offensive. « Le système actuel de négociation salariale pourrait s’effondrer et cela fait très peur aux employeurs pour qui la transparence salariale représente « une charge insoutenable », prévient Lotta Savinko, vice-présidente d’Eurocadres. Contrairement à une idée reçue, la situation des travailleuses finlandaises reste pourtant peu enviable, « avec des écarts salariaux persistants, inexpliqués et toujours plus grands au fur et à mesure que l’on monte dans la hiérarchie ». Dans l’Europe des 27, cet écart atteint 23 % entre les femmes et les hommes managers, selon les données d’Eurostat.
En France, la concertation amorcée en mai 2025 a pris du retard. « Le patronat se sent donc pousser des ailes », commente Sarah Legrain, vice-présidente de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, membre du Haut conseil à l’égalité, au sein de la commission « Stéréotypes et rôles sociaux ». Dans une contribution à la concertation des partenaires sociaux, le Medef donne le ton en plaidant pour une transposition « pragmatique » de la directive. C’est-à-dire, en langage patronal, « la moins contraignante possible pour les entreprises », certaines mesures pouvant être « potentiellement contreproductives et négatives pour l’emploi ». Il y conteste notamment le périmètre des entreprises concernées, s’inquiète du futur régime de sanctions et tente de vider en partie de sa substance le principe de « salaire égal pour un travail de valeur égale ».
Quatre critères à respecter pour des systèmes non sexistes
Ce principe constitue pourtant le cœur de l’initiative législative européenne. Il est un outil d’autant plus puissant, montre Agnieszka Piasna, chercheuse à l’Institut syndical européen, qu’à peine un quart des Européen·nes travaillent dans des secteurs mixtes en termes de genre, ce qui rend difficiles les comparaisons et, donc, la mesure des discriminations. Selon la directive, les États membres devront décider d’outils ou de méthodes permettant de mettre en place des systèmes non sexistes d’évaluation et de classification des emplois. Le « salaire égal pour un travail de valeur égale » y est défini par quatre critères principaux : les compétences (y compris relationnelles), les efforts, les responsabilités et les conditions de travail.
En France, le principe fait déjà l’objet d’un article du Code du travail, modifié par la loi Roudy de 1983 : « Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et de charge physique ou nerveuse ». Mais, parce que les analyses continuent à privilégier le rôle joué par la ségrégation professionnelle, c’est-à-dire la concentration des emplois, il reste en pratique peu développé.
C’est encore trop pour le Medef qui, tout en critiquant la pertinence des critères retenus par le législateur européen, – comme les conditions de travail – demande d’accorder aux entreprises « une marge de liberté suffisante » pour définir les périmètres de comparaison des rémunérations, à toutes les étapes du cycle d’emploi. Il remet également en cause le principe d’un « comparateur hypothétique » (au niveau interprofessionnel ou de la branche) prévu pour les postes où il n’existe pas de comparaison réelle, en plaidant pour que cette comparaison s’exerce au sein de la seule entreprise. Secrétaire nationale de l’Ugict-CGT, Emmanuelle Lavignac prévient : « Malgré un corpus législatif conséquent et un index égalité, dont plusieurs études ont mis en évidence les insuffisances, les écarts de salaire ne se réduisent pas. C’est pourquoi l’obligation de comparer les emplois de valeur égale peut nous apporter une force qui, jusque-là, nous a fait défaut ». Passage aux travaux pratiques, dès les prochains mois.
* Assurer la parité grâce à la transparence salariale, un guide pratique pour les syndicats européens, Eurocadres, 2025.