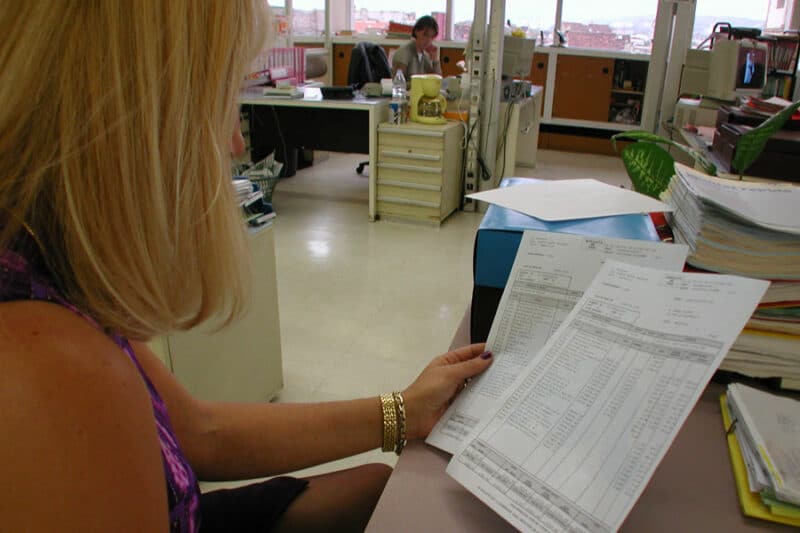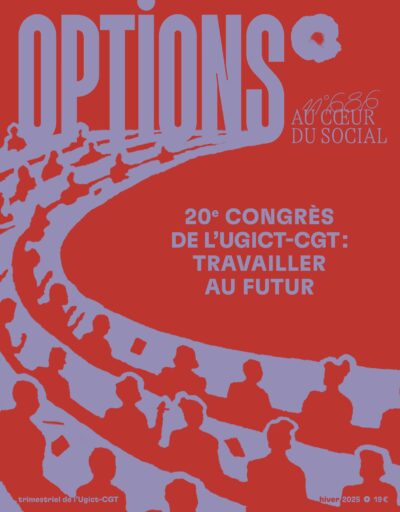Stagnation des salaires, baisse du pouvoir d’achat, sentiment d’injustice, défiance… Sur la base d’une enquête menée par Ipsos en mai 2025 auprès de 4 001 salarié·es du secteur privé, l’Apec (Association pour l’emploi des cadres) et Terra Nova éclairent le rapport des différentes catégories socioprofessionnelles à leur rémunération.
Une majorité de salarié·es (55 %) jugent leur situation financière très juste, difficile, voire très difficile, constatent Suzanne Gorge et Thierry Pech, respectivement directrice générale adjointe et directeur de Terra Nova, dans une note publiée le 24 septembre. Cette « crispation » sur le pouvoir d’achat concerne employés, ouvriers et professions intermédiaires. Mais elle n’épargne pas les cadres, même si ces derniers sont davantage préservés : 44 % d’entre eux estiment que leur pouvoir d’achat a baissé au cours des cinq dernières années ; ils sont encore plus (57 %) à redouter une trajectoire similaire dans le futur. Cette inquiétude est d’ailleurs largement partagée : une large majorité (60 %) s’inquiète de l’évolution future de son salaire, une crainte exprimée par 74 % des professions intermédiaires.
Salaire et pouvoir d’achat, deux combats ?
Ce pessimisme est avant tout nourri par une perception sombre de la situation économique mondiale, et plus encore nationale, alors que 66 % des interrogé·es se déclarent plutôt confiants sur la situation économique de leur entreprise. La catégorie des cadres mise autant sur leur employeur que sur les pouvoirs publics pour améliorer son pouvoir d’achat. « Peut-être parce qu’ils et elles mesurent, mieux que les autres, les capacités de leur organisation ou parce qu’ils et elles ont davantage de leviers pour obtenir satisfaction », analysent les signataires de l’enquête.
Employé·es, ouvrières, ouvriers et professions intermédiaires estiment que leur pouvoir d’achat dépend d’abord des pouvoirs publics. Ces catégories jugent majoritairement que l’entreprise, en particulier lorsqu’elle est petite, ferait de son mieux compte tenu de ses marges de manœuvre (56 %), qu’elle rémunèrerait correctement ses salarié·es (57 %) et qu’elle se montrerait juste dans l’attribution de ses augmentations (52 %).
Déception des 55 ans et plus
En dépit de cette apparente indulgence, les critiques sont nombreuses. L’enquête interroge onze critères d’appréciation de la rémunération, parmi lesquels les efforts et l’investissement dans le travail, les compétences, l’expérience, l’ancienneté, la qualification, etc. Le rapport entre le niveau de salaire et les trois premiers critères est particulièrement décevant pour la majorité des interrogé·es.
Dans le détail, des nuances importantes apparaissent selon les segments du salariat. Les ouvriers, plus que la moyenne, évoquent un manque de reconnaissance de la pénibilité et de l’utilité sociale de leur travail. Globalement, la rémunération est perçue comme étant déconnectée du niveau de responsabilité (41 %). Voire du niveau d’études : cette critiquement est plus fortement exprimée par les femmes (44 %) et les titulaires d’un Master ou d’un doctorat (53 %). Les 55 ans et plus, y compris chez les cadres, se plaignent de la traduction en salaire de leur expérience, de leurs compétences ou encore de leur utilité dans l’entreprise. « Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, le sentiment d’être trop faiblement rémunéré au regard de ses contributions croît avec l’âge », souligne l’Apec.
Mais c’est surtout chez les professions intermédiaires que s’exprime le plus fort sentiment d’injustice. Les analystes consacrent toute une partie de leur étude à cette catégorie, dont le sentiment de dégradation du pouvoir d’achat est le plus élevé. Même si elles ne sont pas les plus en difficulté, « les professions intermédiaires sont sans doute la catégorie la plus frustrée ». Leur niveau de qualification est souvent supérieur à celle des ouvrières, ouvriers et employé·es mais, du fait de l’inflation et de la hausse automatique du Smic, leur rémunération est rattrapée par les bas salaires.
La note se penche également sur l’immobilité des salaires : près d’un tiers des ouvrières, ouvriers, employé·es et professions intermédiaires y sont confrontés depuis cinq ans. Une situation en lien, en partie, avec leur faible propension – par rapport aux cadres – à demander une augmentation et à l’obtenir. « Cette incapacité à réclamer ne serait pas pénalisante dans un monde où domineraient la négociation et les augmentations collectives », commentent sobrement les auteur·es de l’enquête.
Opacification des politiques salariales
Primes individuelles, intéressement, participation, épargne retraite, avantages en nature… Trois salarié·es sur cinq perçoivent ce type de compléments de salaire. Mais 45 % des femmes interrogées, 44 % des employé·es, 61 % des salarié·es à temps partiel ou encore 53 % des salarié·es des petites entreprises ne sont pas concernés. « Dans ce système, les cadres apparaissent comme les principaux bénéficiaires : leur rémunération repose sur un ensemble d’éléments variables et évolutifs (NDLR : au-delà du salaire), qui leur offrent des leviers de reconnaissance multiples, résument les auteur·es. À l’opposé, pour les ouvriers et employés, le salaire reste souvent la seule forme tangible de reconnaissance — et progresse peu. Quand il évolue, c’est essentiellement par le biais d’augmentations collectives (dont les revalorisations du Smic), sans valorisation des situations individuelles. »
Tout cela participe de l’opacification des politiques salariales. L’étude montre que la composition des rémunérations apparaît de moins en moins lisible à leurs bénéficiaires, tandis qu’un·e salarié·e sur deux (49 %) juge opaques les motifs d’augmentation. Le « manque de transparence alimente des doutes nombreux quant à la justice et à la justesse des politiques de rémunération », résume l’enquête.
Des pistes de revendications
Les salarié·es attendent donc une clarification des critères et des mécanismes d’augmentation et, avant cela, de fixation des salaires, pour une « juste rémunération ». Cette attente, notent les deux partenaires de l’étude, pourrait trouver des réponses avec la transposition de la directive européenne sur la transparence salariale. Adoptée en mai 2023, elle impose aux entreprises le respect du principe de l’égalité de rémunération à travail égal ou de valeur égale.
Enfin, si « le poids de la rémunération est majeur » dans la reconnaissance, elle doit s’accompagner d’autres éléments, insistent les auteurs : se sentir valorisé dans l’entreprise multiplie ainsi par 1,9 les chances de se dire « gagnant » ; disposer de perspectives d’évolution professionnelle ou encore recevoir des retours et conseils de son supérieur, par 1,5. Mais aussi, par 1,4, le fait d’avoir une charge de travail supportable ou ne pas faire d’heures supplémentaires.