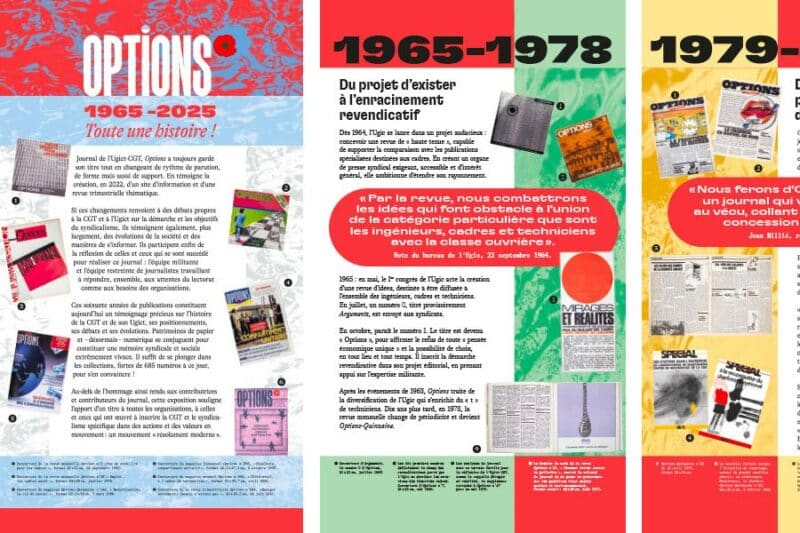« Depuis notre 19e congrès, à la sortie de crise du Covid-19 et dans un contexte de poussée massive de l’extrême droite, nous faisons le constat que notre slogan “Tout est à nous” était bien choisi », souligne Caroline Blanchot, secrétaire générale sortante, en introduction d’un rapport présenté à sept voix. « À l’ouverture de ce 20e congrès, jamais la conscience que le capitalisme nous conduit dans une impasse économique, sociale et environnementale n’a été aussi prégnante. Jamais le souhait des cadres, ingénieur·es et professions intermédiaires de s’organiser collectivement ne s’était fait sentir aussi fortement. »
Durant le mandat, « nous sommes parvenus à imposer une autre vision des possibles face au capital », comme avec la bataille des retraites. « Le bilan de la mobilisation de 2023 montre que les Ictam se sont massivement engagé·es. » Plus de 20 % des cadres ont déclaré avoir fait grève. Pourtant, combien on adhéré ? Pas assez pour changer la donne, du fait notamment d’un déficit d’organisation. Or « quand nous sommes organisé·es, et que nous parvenons à construire l’unité syndicale, nous fracturons le front patronal ».
La bataille des retraites, insiste-t-elle, n’est pas terminée. « L’abrogation de la réforme de 2023 est désormais perçue comme un enjeu de stabilité gouvernementale. C’est l’occasion de porter plus fort nos revendications spécifiques sur la prise en compte des années d’études et de la pénibilité », en s’appuyant sur la victoire des cheminotes cheminots qui ont obtenu un accord collectif d’amélioration des départs anticipés.
« L’Europe est un espace à part entière de notre syndicalisme de classe. »
Le choix stratégique de porter l’Ugict à la direction d’Eurocadres a permis des avancées, souligne Agathe Le Berder, secrétaire générale adjointe sortante, en félicitant Nayla Glaise, réélue présidente de cette structure. « À son actif, un énorme travail sur la transposition de la directive sur la protection des lanceurs et lanceuses d’alerte ; les directives sur la transparence salariale, le devoir de vigilance, les CE européens, la lutte contre les procédures-bâillons ; le règlement sur l’IA et le travail en cours sur le management algorithmique dans le travail des plateformes. Cette stratégie syndicale européenne nous permet de partir à l’offensive. » En particulier pour obtenir des directives et leur transposition, à un haut niveau, sur le télétravail et le droit à la déconnexion, en s’appuyant notamment sur l’Observatoire du télétravail.
« Jamais la colère salariale des Ictam n’a été aussi forte. Dans nos baromètres, le salaire arrive en tête de leurs priorités. Cette nouvelle donne, induite par l’inflation et la non-reconnaissance de nos qualifications, permet de braquer la lumière sur le conflit entre capital et travail se jouant sur nos rémunérations. […] Les fonctionnaires des catégories A et B sont singulièrement visé·es, avec une perte de pouvoir d’achat catastrophique en vingt ans. » Mais une nouvelle conscience collective émerge, illustrée par les fortes mobilisations du 8 mars, les grèves massives de fonctionnaires contre les jours de carence ou les débats sur taxe Zucman.
Le débat sur le partage des richesses continue de s’éclaircir, se félicite Olivier Dupuis, secrétaire national sortant. Qui poursuit, en évoquant le plébiscite pour l’indexation des salaires sur les prix ou la revendication CGT du salaire à la qualification : « Nous parvenons à convaincre sur nos idées sur les salaires. » Il insiste également sur le déclassement des professions intermédiaires et l’hostilité à la nouvelle classification dans la métallurgie, pour que la qualification reste attachée à la personne, et non au poste.
« 32 % des cadres et 41 % des professions intermédiaires sont prêts à se mettre en grève pour gagner des hausses de salaire. »
« Or cette colère des métallurgistes qualifié·es à responsabilité a pu se transformer en départs silencieux des entreprises. Nous ne pouvons collectivement pas accepter que ces salarié·es quittent définitivement l’industrie parce que leurs qualifications ne sont pas reconnues. Il ne peut y avoir de transformation des stratégies industrielles et de l’appareil productif en vue de la bifurcation écologique sans respect des droits sociaux et salariaux des Ictam. »
Fabienne Tatot, secrétaire nationale sortante, poursuit : « Le congrès est le moment de nous interroger sur le syndicalisme spécifique que nous voulons construire pour bâtir un futur émancipateur. » Face à l’irresponsabilité des employeurs qui n’anticipent pas les défis, il y a urgence à « reprendre la main ». Travailler au futur, c’est affronter le défi climatique, s’opposer aux politiques climato-sceptiques visant les services publics, la recherche et les savoirs en général. Vis-à-vis des Ictam, « notre rôle est de les aider à utiliser leur responsabilité professionnelle pour imposer des alternatives » dans l’armement, la filière électronique, l’automobile et les chemins de fer, où un projet alternatif a été conçu à partir des salarié·es, avec la contribution active de l’Union fédérale des cadres et maîtrises.
« “Travailler au futur” c’est faire face à la menace de l’extrême droite. »
Cyril Dallois, secrétaire national sortant, pose ainsi le contexte : « La multiplication des guerres est attisée par la mise en place d’une internationale d’extrême droite qui va des États-Unis à la Russie, en passant par l’Argentine, la Hongrie, Israël et l’Inde. Souvent poussée par les fondamentalismes religieux de tous bords, elle s’attaque désormais aux organisations internationales, dont l’Organisation internationale du traavil. »
Des peuples sont agressés, dont les peuples ukrainien et palestinien, ce dernier subissant des attaques à visée génocidaire de la part du gouvernement israélien d’extrême droite. « Sont particulièrement visé·es celles et ceux qui sont les piliers de leurs communautés, comme l’enseignant et militant Awdah Al Hathaleen, assassiné de sang froid par un colon israélien en Cisjordanie […]. À Gaza, l’armée israélienne cible pour tuer des journalistes, des médecins et des infirmières, a bombardé les écoles et les universités » […]. Nous adressons notre totale solidarité à tous les peuples victimes des guerres et appelons à la construction d’une paix juste et durable », poursuit-il en saluant les mobilisations organisées sur les lieux de travail pour faire cesser les conflits.
Cible privilégiée, également, de l’extrême droite : le professionnalisme des Ictam. « Nos responsabilités sont attaquées car elles permettent à la démocratie et à la devise républicaine issue de la Révolution, “Liberté, égalité, fraternité”, d’exister au quotidien », souligne Emmanuelle Lavignac. Qui évoque ensuite la France de Vichy lorsque Philippe Pétain fait adopter le statut des Juifs leur interdisant d’exercer certaines professions. « Cette France gouvernée par l’extrême droite a aussi dissous par décret les syndicats, dont le premier d’entre eux : la CGT. […] Face à l’internationale d’extrême droite qui se structure, les Ictam ont un rôle central à jouer et nous devons les organiser. » Désormais, la menace est clairement alimentée par les grands patrons qui utilisent leurs capitaux et leur influence pour diffuser largement ses idées.
Face au déploiement de l’intelligence artificielle (IA), il faut aussi imposer un projet alternatif participant de cet objectif. Elle argumente : « L’IA utilisée pour perturber les élections, influencer des votes ou décourager l’action collective est portée par les patrons des Gafam ralliés à Trump. » Pour sa part, le Medef y voit un moyen de mettre fin au « diplôme à vie ». Or ce sont les Ictam qui produisent, conçoivent et développent l’IA, à partir de leur expertise et de leur technicité. L’Ugict, qui pilote le groupe de travail confédéral, propose d’« agir pour écrire une autre histoire de l’IA en gagnant, sur les plans européen et mondial, une directive et une convention OIT sur l’IA au travail. »
« “Travailler au futur”, c’est s’inspirer du courage et de l’optimisme des militants du passé. »
Les Ictam nous ont montré la voie d’une résistance possible, commence par dire Sylvie Durand, secrétaire nationale sortante. Avant de décrire comment « les salarié·es qualifié·es à responsabilité ont apporté leur contribution au programme du Conseil national de la Résistance et à son inestimable héritage qu’est la Sécurité sociale, dont nous célébrons les 80 ans ». C’est « défendre [cet] héritage que de souhaiter que la hausse des qualifications permise par l’éducation de masse soit valorisée par l’ensemble de la société […]. La hausse continue de la part des diplômé·es du supérieur est un levier pour tout transformer ».
Au total, 42 % des nouvelles et nouveaux adhérents à la CGT ont moins de 35 ans, dont une très large proportion d’Ictam. Or cette jeunesse diplômée, engagée, veut se défendre et se mobiliser. Notamment pour répondre aux défis climatiques. « C’est parce qu’elle s’indigne des conséquences sociales du capitalisme et que ce constat les rapproche de la CGT, que nous devons l’accueillir et la convaincre de transformer sa colère en une force collective », explique Agathe Le Berder.
Mais qu’attend cette jeunesse du syndicat ? « Qu’il lui permette d’agir pour une transformation écologique et humaine du travail, contre le racisme, le sexisme, le validisme, l’âgisme, les discriminations de genre et sexuelles… toutes formes de discriminations, qui accentuent l’exploitation. » Et qu’attend la CGT de cette jeunesse ? « Qu’elle organise ses pair·es, plutôt que de se concentrer sur la situation des ouvrières, ouvriers et employé·es, qui n’ont pas besoin des Ictam pour s’organiser à partir de leurs problématiques. Attention : si ces profils de jeunes Ictam qui nous rejoignant ne sont pas orientés vers l’activité spécifique, ils et elles risquent de prendre la place des ouvrières, ouvriers et employé.es dans la conduite de notre organisation. »
« Travailler au futur, c’est militer en tant qu’Ictam. »
Olivier Dupuis propose pour cela de s’appuyer sur l’Accord national interprofessionnel sur l’encadrement de 2020, qui énonce plusieurs critères pour les définir. Un premier est la responsabilité, avec des Ictam à la fois « vecteurs » et « victimes » des politiques patronales. Un deuxième est la qualification, dont la reconnaissance fait l’objet d’une intense bataille collective. « La définition de l’encadrement permet d’intégrer, comme assimilé·es cadres, la quasi-totalité des professions intermédiaires. […] 62 % de ces salarié·es sont diplômé·es du supérieur, sont donc Ictam au sens de nos cahiers revendicatifs et relèvent du spécifique au sens de nos statuts confédéraux […]. Les professions intermédiaires sont le socle de l’Ugict, puisque 55 % des adhérentes et adhérents Ictam de la CGT relèvent du 2e collège ou de la catégorie B. » Leur technicité est dans le même temps attaquée par le patronat, pour mieux constituer une catégorie non-cadre, niant leurs rôles et leurs qualifications. Un troisième critère, enfin, l’autonomie, est dévoyée par le patronat du fait notamment de politiques managériales individualisantes.
Question : l’afflux d’Ictam enregistré durant le mandat – 10 000 affiliations supplémentaires – doit-il se traduire par moins ou plus de spécifique ? Cette progression historique témoigne d’une confiance confirmée dans l’organisation. Parce qu’elles et ils sont plus nombreux, « la tentation serait grande de se dire qu’ il n’est pas nécessaire de conserver une activité spécifique”, alors qu’au contraire, la prise en compte de la spécificité est cruciale, répond Fabienne Tatot : pour les Ictam eux-mêmes et elles-mêmes, pour les ouvrières, ouvriers, employé·es, et pour la CGT. » Le spécifique n’est pas la loi du nombre. Il est nécessaire pour trois raisons : revendicative, de vie syndicale et de stratégie, en étant présents dans les lieux où se prennent les décisions.
Le spécifique, une construction vertueuse
Cyril Dallois appuie : « Quand les Ictam construisent des syndicats spécifiques, il y a plus de syndiqué·es, plus de candidates et de candidats sur les listes dans leurs collèges, de meilleurs résultats aux élections, et un engagement dans nos actions plus important. » Il poursuit : « La force des syndicats est décuplée quand elles et ils sont organisés. L’Ugict, au niveau national, ne peut pas seule coordonner les dizaines de syndicats spécifiques, et encore moins les 130 000 Ictam syndiqué·es dans les 30 000 bases CGT. C’est une question d’efficacité ! Les Ufict sont des actrices essentielles pour travailler la spécificité dans les professions. Elles ne concurrencent pas leurs fédérations, mais les aident à identifier et à maîtriser les enjeux, puis à construire et à impulser l’activité. » De la même manière, leur travail nourrit l’activité des commissions départementales.
C’est à une projection sur les jours à venir qu’invite ensuite Emmanuelle Lavignac, pour la construction collective d’une vision émancipatrice du travail. Elle évoque deux propositions : primo, lancer une campagne sur la définanciarisation des entreprises ; secundo, renforcer les liens entre les mandaté·es du spécifique au sein des instances internationales de leurs groupes.
En matière de conditions de travail, tous les indicateurs sont au rouge. « Dans la mise en œuvre des politiques patronales, on retrouve deux éléments essentiels. Le premier, ce sont les manageuses et manageurs “entre le marteau et l’enclume”, chargés d’appliquer la cure d’amaigrissement imposée par le patronat. La CGT les organise dans son Ugict pour qu’ils et elles puissent contribuer, au même titre que les autres salarié·es, à la construction d’un management alternatif […]. Le second élément renvoie aux outils numériques qui sont au cœur de la démarche patronale de recherche permanente d’optimisation. » Sur l’IA, il est proposé de créer une consultation adaptée au périmètre d’activité des syndicats pour les aider à reprendre la main. Parce que cette technologie ouvre un nouveau débat sur le partage des gains de productivité, il est proposé de poursuivre la campagne sur la réduction du temps de travail.
Autre proposition, formulée par Sylvie Durand : « Débuter le mandat par une bataille sur la transposition de la directive européenne relative à la transparence salariale. » Sur les retraites, le rapport suggère d’amplifier la mobilisation contre les piliers de la doxa patronale, dont la réduction du niveau des pensions pour inciter à la capitalisation. « Les prochains budgets de la Sécurité sociale et la renégociation de l’accord Agirc-Arrco en 2027 pourraient nous permette de défendre le relèvement du niveau de pension et la prise en compte des années d’études […]. Travailler au futur, c’est plus de Sécurité sociale, et moins d’extrême droite ! » C’est aussi rompre avec le Wall Street management alors que « comme salarié·es qualifié·es, conscient·es de nos responsabilités, nous appelons à la démocratie au travail ».
« Travailler au futur, c’est donner toute sa place à la négociation collective et au rapport de force. »
Caroline Blanchot invite à agir sur plusieurs autres fronts : construire une proposition de loi pour l’inscription du droit de refus et de proposition dans le Code du travail ; poursuivre les travaux sur la protection des lanceuses et lanceurs d’alerte ; mettre en place un plan d’action pour mettre fin aux abus et violences contre les syndicalistes.
Contre l’extrême droite, « il nous faut nous renforcer. Pierre Semard, secrétaire général de la fédération CGT des Cheminots et dirigeant communiste, résistant fusillé par les nazis, déclarait en 1937 que la syndicalisation des salarié·es qualifié·es à responsabilité était essentielle face aux dangers de son époque. Il fallait pour lui “empêcher les tentatives du fascisme de dissoudre nos forces et de mettre de son côté les techniciens et les cadres.” Il est le premier dirigeant de la CGT à avoir intégré 15 000 d’entre eux avec leur structuration du local au national. Alors que ces cheminots cadres faisaient du syndicalisme catégoriel à l’extérieur de la CGT, ils ont pu bâtir les fondations du syndicalisme spécifique de la CGT et bâtir leur union fédérale des cadres et maîtrises. Ni “CGT bis”, ni think tank, nous sommes l’organisation que la CGT nous demande de construire pour unir, mobiliser le salariat et gagner ! »
Pour conclure, rendez-vous pris pour les prochaines mobilisations : le 22 novembre contre les violences sexistes et sexuelles ; le 29 novembre en solidarité avec le peuple palestinien ; le 2 décembre pour exiger l’abrogation de la réforme des retraites. « Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très beau 20e congrès de l’Ugict. Vive la CGT et son union générale des ingés, cadres, techs ! »