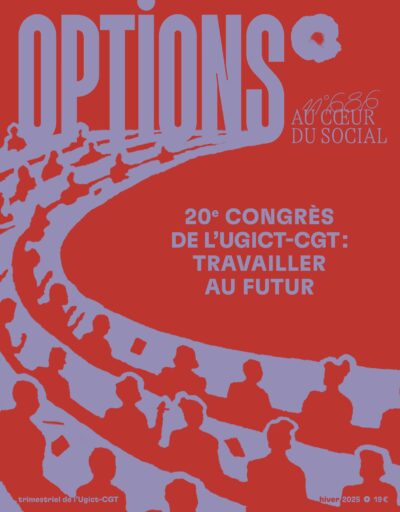« Rien n’est écrit d’avance » : en ouvrant son adresse au 20e congrès de l’Ugict, à Metz, Sophie Binet a repris le slogan du 18e congrès comme un leitmotiv. Pour en faire l’emblème de la Lorraine « marquée par les luttes pour l’industrie », comme celles des Novasco. Pour se féliciter de la mobilisation citoyenne « dans laquelle la CGT a joué un rôle central » qui a déjoué le scénario écrit des dernières élections législatives. « En deux ans et demi, nous avons fait tomber cinq gouvernements, tombés à cause de la violence sociale de leur politique et de leur refus d’abroger la réforme des retraites. Et ça va continuer ! », lance-t-elle.
Tout en appelant à la « lucidité », face à la menace imminente de l’extrême droite, aujourd’hui renforcée par l’« émergence du capitalisme libertarien de Trump et de Musk dont l’objectif est de supprimer toutes les normes pour les remplacer par la loi du plus riche ». Or, face à ce technofascisme porté par les Gafam, « le rôle des professions qualifiées est déterminant. Les organiser, c’est se donner les moyens de peser sur la finalité comme sur l’usage des technologies. »
La CGT, de toutes les mobilisations pour la paix
Il est en effet minuit moins une. La montée de l’internationale d’extrême droite, qui fait fi du droit, accompagne l’explosion des conflits armés. « Grâce à notre internationale ouvrière, à la Confédération syndicale internationale, à la Confédération européenne des syndicats, à Eurocadres, nous portons la paix. » La CGT pleure aussi tous les morts : « Les 1 000 civils israéliens tués le 7 octobre par le Hamas, comme les 70 000 Gazaouis assassinés par l’armée israélienne dans ce qu’il faut désormais clairement qualifier de génocide », souligne-t-elle en prenant date pour la mobilisation du 29 novembre en soutien au peuple palestinien. « Notre position est claire. En Ukraine, comme en Palestine, nous voulons le respect du droit international, et cela signifie une solution à deux États. »
Elle poursuit : « Nous refusons aussi la mise en opposition entre racisme et antisémitisme pour empêcher la supercherie de l’extrême droite. Cette dernière tente désormais de faire croire qu’elle lutterait contre l’antisémitisme alors qu’elle est toujours aussi négationniste. Or, on ne lutte pas contre l’antisémitisme par un autre racisme. C’est le sens de la campagne intersyndicale que nous avons lancée pour lutter fermement contre le racisme et l’antisémitisme qui se banalisent comme jamais sur nos lieux de travail. » Elle dénonce la course aux armements, financée par une réorientation des richesses socialisées. « Nous refusons que l’on ferme des lits d’hôpitaux pour construire des canons ! »
Éviter le piège de la division, unir le camp du travail
Comment lutter ? En liant en permanence les questions sociales et sociétales. « Notre responsabilité syndicale, c’est de porter sur nos lieux de travail la lutte contre le racisme et le sexisme. Le syndicalisme, c’est le meilleur levier pour lutter contre l’extrême droite, car le travail rassemble. Quelles que soient notre couleur, notre religion, notre identité sexuelle, nous sommes réuni·es par l’objectif de bien travailler, et rassemblé·es par nos revendications face aux patrons. » Elle met en garde contre le piège de la division : « Partout, faisons primer ce qui nous rassemble sur ce qui nous divise pour unir le camp du travail. »
Pour cela, il faut permettre aux Ictam de s’organiser, un enjeu stratégique pour la CGT qui ambitionne de reprendre la place de première organisation syndicale du pays. « Ce sera l’objectif de notre 54e congrès confédéral. L’objectif sera d’être le syndicat des ingénieur·es cadres et techs des grandes entreprises en répondant à leurs problématiques spécifiques. L’objectif, sera d’organiser les salarié.es des ETI et des PME en développant des syndicats professionnels de territoire. L’objectif sera de se renforcer dans le secteur tertiaire, le commerce, les services, la logistique, les banques… »
Alimenter l’activité spécifique, se donner les moyens de progresser
Les points d’appui sont nombreux. D’abord parce que les Ictam sont concentrés dans les grandes métropoles et dans les grandes entreprises, les collectivités, la fonction publique d’État et hospitalière. « Nous pouvons donc faire un travail de ciblage et nous donner comme objectif au congrès confédéral que les quinze villes rassemblant plus de 50 % des Ictam aient les moyens d’avoir une commission départementale Ugict. Ou, dans tous les groupes du Cac 40, mettre en place une coordination de groupe et un coordinateur Ugict pour alimenter l’activité spécifique et progresser dans les 2e et 3e collèges. »
Second point d’appui : l’intérêt des Ictam pour la CGT, inquiets qu’ils et elles sont de la montée de l’extrême droite, et lucides sur l’impasse sociale et environnementale de la financiarisation de l’économie et de leur travail. Sophie Binet salue ainsi le bond inédit des affilié·es à l’Ugict au cours du mandat et affirme : « La CGT a besoin des Ictam pour se déployer en direction des Ictam. C’est ce qui permet d’organiser un rapport de force majoritaire et de transformer les rapports sociaux au travail. Des cadres qui s’organisent collectivement à la CGT, ce sont des cadres qui peuvent travailler et manager autrement, et ont le rapport de force pour imposer le respect de leur éthique professionnelle. » À ce point de son intervention, Sophie Binet insiste sur la nécessité de prioriser les responsabilités spécifiques : « La CGT n’a pas besoin de cadres pour remplacer les ouvriers dans la direction des organisations générales, au risque d’ailleurs de reproduite en son sein les rapports de domination. Elle en a besoin pour se renforcer chez les cadres. »
Des conditions indispensables pour rassembler le salariat
Ce que n’est pas l’activité spécifique ? Avoir deux CGT et refuser le « tous ensemble ». Sophie Binet appuie : « La force de la CGT, ce n’est pas qu’il y en ait deux, mais mille, dix mille, vingt mille, trente mille, autant que le nombre de nos bases ! Reliées par nos valeurs et cimentées par la pratique d’un syndicalisme de classe et de masse, à partir des besoins des salarié·es. C’est pareil pour les luttes ou les convergences d’intérêts […]. C’est une force pour la CGT d’avoir une large diversité ».
Elle développe son argumentation en évoquant la grève des mineurs de 1941 qui, aux heures les plus sombres de l’occupation allemande, s’est d’abord nourrie du désastre de leurs conditions de travail, mais a été rendue possible par l’action syndicale de la CGT. « La leçon ? Pour gagner une grève de masse, il faut toujours et d’abord partir de revendications très concrètes. C’est ensuite que le travail militant oriente la colère et donne la dimension politique de la lutte. » Pour les Ictam, cela impose de partir des revendications qui les concernent directement, comme le télétravail.
Ce principe, il doit être appliqué à la préparation de la journée de mobilisation du 2 décembre pour refuser le projet de budget. Après avoir déjà obtenu un certain nombre de victoires – sur les jours fériés, le décalage de la réforme des retraites… –, « ce n’est pas le moment de s’arrêter ! » En conclusion, elle transmet au congrès un « immense merci au nom de toute la CGT » : pour une activité précurseuse sur de nombreux sujets (management, égalité professionnelle, droit à la déconnexion, télétravail, lanceurs d’alerte, intelligence artificielle, radar travail environnement… » ou pour le lancement et le dynamisme du collectif Jeunes diplômé·es. « Avec l’Ugict, ses productions, ses militants et militantes, nous avons un trésor entre les doigts […]. Vive la CGT et vive son Ugict ! »