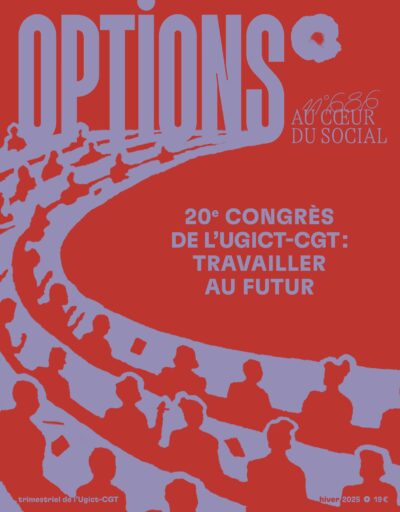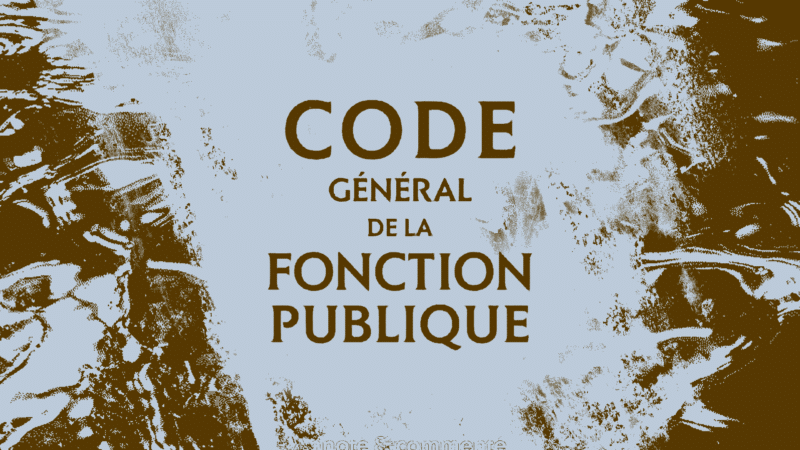Les droits ne s’usent que si l’on ne s’en sert pas… ou si l’on est empêché de les exercer. Association loi 1901 créée en octobre 2018 par 17 associations et syndicats, parmi lesquels l’Ugict-Cgt, la Maison des lanceurs d’alerte (Mla) vient de publier un nouveau guide pratique, précieux en cette période où la vérité semble appartenir à ceux qui ont le pouvoir d’empêcher toute contradiction.
En 2022, un premier guide, Lancer l’alerte, s’adressait aux personnes détenant des informations sans savoir comment les révéler. Le livret, nourri de témoignages, détaillait les textes définissant et protégeant les lanceurs d’alerte. Leur statut a été acquis de haute lutte, d’abord avec la loi Sapin II de décembre 2016, puis avec une directive européenne de 2019, transposée en France par la loi du 21 mars 2022.
À lire : Avec l’adoption de la loi Waserman, les lanceurs d’alerte enfin mieux protégés
Dès 2019, l’Ugict constatait que nombre de lanceurs d’alerte étaient des salariés en conflit éthique avec leur entreprise, qu’ils soient témoins ou instruments de pratiques contraires à l’intérêt général, impactant la santé publique, l’environnement, usant de méthodes comptables ou sociales illégales par exemple.
L’Ugict a alors réalisé un guide pour les aider à ne pas se mettre en danger, à connaître leurs droits et à trouver du soutien, en particulier auprès d’un syndicat. Le guide s’adresse donc aussi aux syndicalistes accompagnant un ou une collègue qui veut dénoncer les pratiques illégales de son entreprise. Tous les lanceurs d’alerte le disent : la première urgence quand on a une information confidentielle ou potentiellement scandaleuse à révéler, c’est de ne pas être isolé. C’est souvent difficile d’obtenir le soutien de collègues directs, voire impossible quand il s’agit d’un supérieur hiérarchique éventuellement impliqué ou acceptant l’omerta. Mais c’est possible auprès des syndicalistes, à condition de savoir comment procéder.
Pas de « vigies de la démocratie » sans porte-voix médiatiques
La directrice générale de la Mla, Élodie Nace, l’a rappelé ce 24 avril, à la soirée de lancement du nouveau guide : plus de 400 lanceurs et lanceuses d’alerte ont été épaulés par l’association depuis sa création, via un « accompagnement juridique, psychologique, social, financier, médiatique » Le nouveau guide, Médiatiser une alerte, est consacré à la relation entre lanceur d’alerte et journaliste, qui « s’avère à haut risque, à chaque étape », d’où l’importance de bien maîtriser le « cadre juridique ». En effet, « si les textes semblent offrir la protection de principe des sources journalistiques et celle des lanceurs d’alerte, ils sont parfois sujets à interprétation et complexes à appliquer ».
Le mot clé, c’est la confiance. Lanceurs d’alerte, Houria Aouimeur (Affaire Ags-Unédic) et Jean-Marc Cantais (violences policières) insistent là-dessus : « On attend des journalistes qu’ils nous écoutent, qu’ils nous aident à rendre légitimes nos révélations, que cela nous protège au moins contre les calomnies », assure la première. « On est parfois perdus face au déni et à l’agressivité des réponses à nos révélations, on ne connaît pas nos droits, on peut y perdre beaucoup, à commencer par son emploi, voire la possibilité d’en retrouver un », complète le second.
Surlignage jaune, surlignage bleu
Comme le rappelle aussi Dominique Pradalié, présidente de la Fédération internationale des journalistes, de nombreux scandales n’auraient pu être révélés sans cette prise de contact – et de risque – entre des sources et des journalistes.
Le guide propose une méthodologie très précise pour que la relation fonctionne. Il applique un surlignage jaune pour s’adresser au journaliste, bleu pour le lanceur d’alerte, et chaque page affiche le drapeau du pays dont la législation est abordée – France, Belgique, Suisse, et droit européen.
Cinq étapes pour « naviguer entre les icebergs »
Le guide décline cinq étapes pour « naviguer entre les icebergs », comme le décrit Antoine Bernard, de Reporters sans frontières. Cela commence avec des conseils au lanceur d’alerte pour choisir le bon interlocuteur et avec les précautions qu’un journaliste doit prendre quand il est contacté. Chacun doit bien comprendre sa place : le journaliste n’est pas le sauveur justicier qui va régler tous les problèmes en un article ; le lanceur d’alerte doit mesurer les risques et la validité de ses preuves.
Chacun doit se protéger, protéger l’autre et être d’accord sur une stratégie commune, sans précipitation. « Il faut conserver tous les documents pour pouvoir répondre à toute attaque et arguer de sa bonne foi. Et savoir par exemple que si on est attaqué en diffamation, un tribunal ne peut pas vous obliger à citer vos sources, mais il peut tout de même vous condamner », témoigne Étienne Merle, du media Les Surligneurs, qui se consacre à la la lutte contre la désinformation juridique, et a été confronté à cette situation lorsqu’il était journaliste indépendant.
Parer les poursuites judiciaires abusives
La grande affaire désormais, quand on a passé tous les obstacles – y compris les intimidations et les menaces pendant l’enquête –, c’est de parer les poursuites judiciaires abusives intentées dans un seul but : retarder ou empêcher les révélations.
On les appelle « procédures bâillons », et en anglais Slapp, pour « strategic lawsuit against public participation », slap signifiant également « gifle »… Le combat n’est pas équitable entre un journaliste indépendant et une grosse entreprise bardée d’une armée d’avocats. Et le droit n’est pas toujours indexé sur l’intérêt général.
Retranchés derrière le secret professionnel
Le guide détaille les différentes sortes de « secret professionnel » que des personnes ou institutions, en France, peuvent invoquer pour s’exonérer de leurs responsabilités : défense nationale, secret médical, certains aspects du Code du commerce. « Cela mobilise énormément de temps et de ressources pour se défendre contre une plainte, qui sera parfois retirée au dernier moment », dénonce Pauline Delmas, chargée de contentieux et plaidoyer à l’association Sherpa.
La complexité du droit et les risques financiers peuvent s’avérer dissuasifs ; les procédures bâillons se comptent par centaines rien qu’en France, et augmentent au fil des ans. Un cas dramatique est celui de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia qui, au moment de son assassinat, en 2017, était sous le coup de 47 procédures judiciaires pour avoir dénoncé les pratiques mafieuses et la corruption dans son pays.
Des sanctions contre les procédures bâillons
La directive européenne 1069, du 11 avril 2024, a posé les bases d’une uniformisation des règles pour empêcher les procédures bâillons, et doit être transposée en droit français d’ici à mai 2026. Toutes les associations de défense des droits humains – en particulier la Commission nationale consultative des droits de l’homme (Cncdh) – exigent que la France aille au-delà de cette directive et empêche ce harcèlement. La Cncdh propose notamment que les amendes sanctionnant une procédure abusive soient au minimum de 60 000 euros, voire soient alignées sur les peines protégeant le secret des affaires, avec affichage obligatoire du jugement, afin de restaurer la réputation des personnes injustement incriminés. Le site web Index on censorship propose également un questionnaire aux journalistes pour identifier s’ils font l’objet d’une procédure bâillon.
Le guide se conclut par un récapitulatif des dix règles d’or de la collaboration journaliste-lanceur d’alerte, un questions-réponses sur quelques notions juridiques, une liste des autorités compétentes par domaine d’investigation, et des fiches pratiques en cas de démarches à entamer ou à subir. À mettre entre toutes les mains tant que ces droits existent !