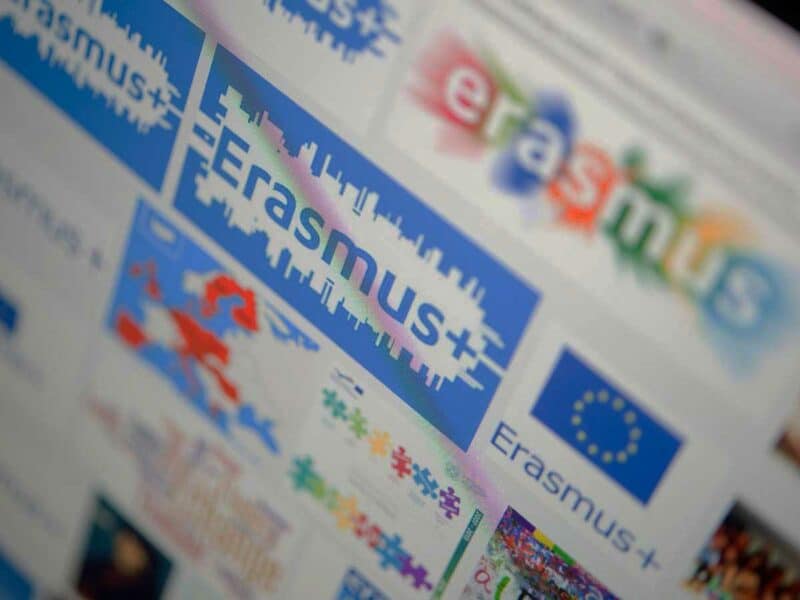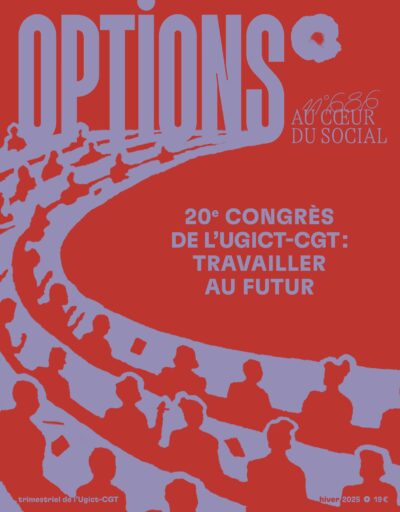Auberge espagnole ou casse-tête chinois ? Trente huit ans après la création en 1987 du programme européen Erasmus, attribuant des bourses d’études à l’étranger pendant un ou deux semestres universitaires, ces expériences connaissent un engouement croissant, en particulier en France, qui en est la première utilisatrice. En 2023, 139 163 personnes en ont ainsi bénéficié, contre 80 000 en 2017. La moitié des bénéficiaires sont des étudiants, le dispositif étant désormais étendu aux scolaires (pour 29 %) et aux personnes en formation de tous âges (pour 18 %).
Dans le supérieur, une expérience à l’étranger, au-delà du parcours initiatique qu’elle peut offrir, semble même perçue comme prioritaire dans une stratégie d’insertion professionnelle et de carrière. C’est ce que confirme le Centre d’études et de recherche sur les qualifications (Cereq) dans son dernier Bref, en s’appuyant sur son enquête Génération 2017.
Un must pour se distinguer
L’enquête, en coopération notamment avec Erasmus+ France, porte sur 15 648 diplômés de la cohorte 2017, dans 30 familles professionnelles accueillant 80 % des jeunes diplômés, qui pour plus de 95 % occupaient des postes de cadres trois ans après. Cette année là, 48 % des diplômés de l’université déclarent avoir accompli un séjour à l’étranger, 29 % à plusieurs reprises, mais seulement 28 % dans le cadre de leurs études supérieures. Pour environ un tiers d’entre eux, ces séjours sont désormais intégrés dans leur cursus obligatoire – en particulier dans les écoles de commerce et d’ingénieurs.
Ces séjours durent six mois en moyenne, la grande majorité se situant en-deçà. La moitié se situent en fin de cursus. La destination est, dans 40 % des cas, un pays anglophone, la maîtrise de l’anglais, langue internationale par excellence, étant devenue incontournable dans l’univers mondialisé de l’entreprise.
Ainsi, 63 % d’entre eux ont la conviction que cette « mobilité diplômante » a facilité leur accès à l’emploi. Dans un contexte de massification des candidats qualifiés, où chacun est sommé de se distinguer, cette expérience internationale est souvent perçue comme un « gage d’ouverture, de dynamisme et de compétences linguistiques » : un sentiment encore plus affirmé dans des métiers comme le tourisme, le commerce, la recherche, la communication, où l’anglais s’avère à la fois un atout et un outil.
Tous secteurs confondus, une ouverture culturelle et une professionnalisation recherchées
Les employeurs y sont sensibles. Ils accordent un « crédit significatif à la mobilité internationale » y compris pour les « cadres commerciaux, technico-commerciaux, cadres d’études et de recherche, ou encore dans les services administratifs et financiers ». L’étude souligne que « plus de la moitié des jeunes » qui y sont recrutés comme cadres « ont connu une expérience de mobilité internationale pendant leurs études supérieures ».
Même dans dans le bâtiment et dans l’agriculture, cette expérience est valorisée car, tous métiers confondus, elle atteste d’une confrontation avec d’autres cultures, qui a permis de se familiariser avec « des méthodes de formation et de travail différentes », voire de nouer des contacts. Autant d’indicateurs qui témoignent d’une bonne capacité d’adaptation et d’initiative. Ainsi, le séjour à l’étranger est perçu par tous comme un « signal d’aptitude », à la fois « révélateur de compétences sociales », de confiance en soi et d’employabilité, même quand ils n’est pas perçu comme indispensable pour la pratique professionnelle – dans les métiers de la santé, d’ingénieurs, de cadres techniques par exemple.
Un impact salarial notable, mais pas systématique
Au-delà, le Cereq a regardé si cette mobilité internationale étudiante avait réellement un impact sur niveau d’emploi, de salaire et de carrière, en particulier pour les jeunes diplômés aspirant à un poste de cadre. Il semble qu’à l’embauche, « l’expérience internationale procure un avantage salarial brut dans 7 des 10 professions étudiées », mais cet effet « ne persiste pas toujours une fois que l’on contrôle les autres caractéristiques (diplôme, origine sociale, etc.) ». Un gain salarial net – toutes choses égales par ailleurs – est toutefois observé dans quatre des dix professions étudiées : « Il est de 7 à 8 % pour les cadres des services administratifs, comptables et financiers, les professionnels de la communication et de l’information. Pour les ingénieurs de l’informatique, il s’élève à 5 %, et à 4,3 % pour les cadres d’études et de recherche. » Dans les métiers des arts et spectacles ou de l’information, près de 80 % des concernés estiment en tout cas que cette expérience s’est avérée déterminante, y compris du point de vue de la carrière et du salaire.
Accessible à tous les budgets ?
L’auteur conclut : « La grande majorité des diplômés du supérieur (quatre sur cinq) tirent profit de leur séjour à l’étranger, que ce soit en facilitant leur recrutement, en obtenant un meilleur salaire, ou en bénéficiant des deux à la fois. Ces résultats soulignent l’importance de la mobilité internationale non seulement pour l’enrichissement personnel mais aussi comme un investissement professionnel rentable. Ils plaident pour un renforcement de son intégration dans les cursus et un soutien accru aux étudiants, notamment ceux disposant de moins de ressources, afin de favoriser l’inclusion, un objectif clé du programme Erasmus+ 2021-2027. »
D’après les derniers chiffres, moins de 40 % des séjours à l’étranger sont aidés par un financement public (Union européenne ou collectivités territoriales). Le programme Erasmus 2021-2027 doit engager – sauf coupes à venir ? – 28 milliards d’euros de fonds publics, pour un budget augmenté de 80 % par rapport à 2014-2020. Il a été présenté comme particulièrement tourné vers le « soutien à l’inclusion » et la possibilité pour tous d’accéder à une expérience de mobilité, en proposant des séjours à des publics vivant dans des territoires enclavés, défavorisés, souffrant de handicaps, dont les bourses ont été revalorisées. Reste que le montant de ces bourses mensuelles, échelonné de 225 à 824 euros, suffit rarement pour vivre une expérience ou une formation à l’étranger sans l’aide de la famille, un emprunt ou un emploi sur place, même peu rémunéré.
Pour l’heure, cette expérience devient un élément incontournable dans la formation, presque au point de se banaliser, sauf que sans aide aux moins favorisés, elle pourrait aussi s’imposer comme un facteur de sélection sociale.
- « Mobilité internationale étudiante : un plus pour accéder aux postes de cadres ? » Arnaud Dupray, Céreq Bref n° 471, juin 2025.