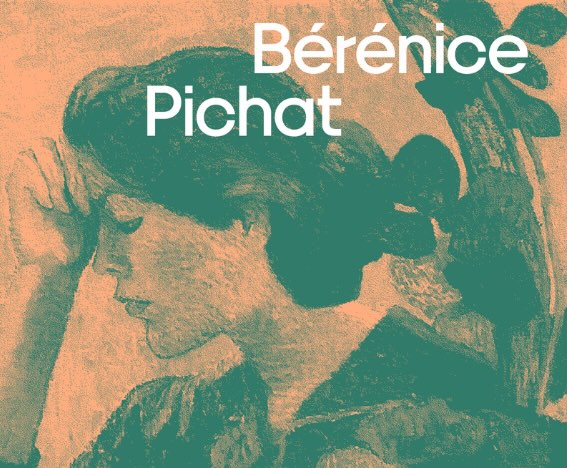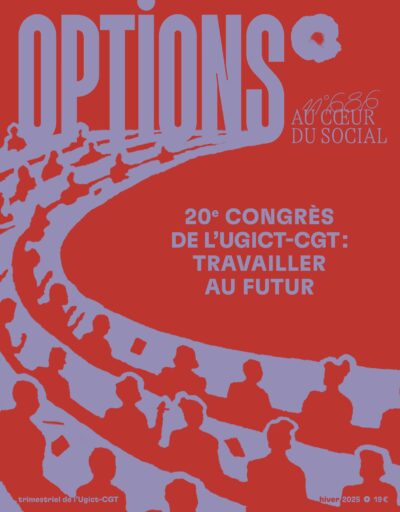Oui, ce roman est paru en 2024, oui, cette chronique est un rattrapage, la réparation d’un oubli, d’une inattention ! Oui, ce roman de Bérénice Pichat ravira les lectrices et lecteurs d’Annie Ernaux, elle qui dit écrire pour « venger sa race » !
Oui, ce roman comblera les admirateurs de Joseph Pontus, dont les vers libres sont inventaire des gestes répétés et spécifiques à l’usine ! Oui, les amateurs de Zola seront transportés à sa lecture ! Quant aux autres, ce roman est aussi pour eux ! Il s’adresse à nous, à nous tous. Il remet du sensible et de la raison dans cette époque de folle déraison.
Des vers courts, simples, familiers et presque rudimentaires
La petite bonne, dans le livre éponyme de Bérénice Pichat, n’a ni prénom ni nom, son métier définit son statut social, sa fonction gomme toute trace d’identité et, pour le reste, elle est aussi invisible que ceux qui, comme elle, « se lèvent aux petites heures pour aller travailler ». Invisible assurément, et souvent inaudible.
Alors, l’autrice conte sa vie, en vers libre, des vers courts, simples, familiers et presque rudimentaires, des vers libres sans aucune ponctuation qui clament le poids d’une vie minuscule et résonnent contre le mur du silence :
Elle arrive enfin à la villa
plongée dans le sommeil
Elle doit passer par-derrière
Dans sa poche
la clé de la porte
L’entrée réservée aux employés
la femme de ménage
la cuisinière
le jardinier
le cocher
le plombier
Les maîtres ne l’empruntent pas
Devant
Il y a une autre entrée
pour les notables
la famille
les invités
Monsieur le curé
Allez en paix mon enfant
quand il la remarque
– c’est rare
Elle lave leurs traces boueuses
sur le sol en damier noir et blanc
Elle ne sait pas jouer aux dames
à force de faire la bonne
Ça elle le fait bien
Parfaitement même
Madame est très satisfaite
Elle l’a dit à Eugénie
la cuisinière
qui le lui a répété
un jour
comme ça
Elle a remarqué un peu de jalousie dans sa voix
Il ne faut pas être trop bien vue
disait sa mère
sa pauvre mère
Elle n’en a pas eu beaucoup
de la reconnaissance
elle
On ne peut pas dire
Vraiment
À son enterrement ils étaient trois
Elle
son homme
et la concierge de son immeuble
Aucun maître ne s’était déplacé
Qui irait aux funérailles d’une bonniche
sinon une autre bonniche
Le menton quasi disparu, amputé des jambes et des doigts
La petite bonne va aussi chez les « Daniel », couple bourgeois. Lui a été excellent pianiste, à l’avenir prometteur. Mais l’avenir prometteur, au début du XXe siècle, a été fracassé par la Grande Guerre. Blaise Daniel est revenu des combats à l’état de gueule cassée, le menton quasi disparu, amputé des jambes et des doigts.
« Les premières semaines, Alexandrine [l’épouse de Blaise] avait organisé des dîners, des visites. Blaise se faisait l’effet d’être en performance : il exécutait les tours qu’on lui avait appris. Il maniait ses pinces, s’essayait à parler, à sourire, en une grotesque pantomime. Complices ou désemparés, les visiteurs applaudissaient, s’extasiaient sur les progrès, posaient des questions. Eux aussi faisaient semblant. Blaise en avait entendu plus d’un soupirer de soulagement en quittant la pièce que lui ne quitterait plus. Après une première invitation éprouvante, peu d’amis revenaient. Au bout d’une année, le silence avait tout envahi. »
« Elle rêve que sa vie se dissolve et disparaisse »
Le huis clos, chez les Daniel, se raconte en prose, car les bourgeois possèdent l’art de la prose : une prose ample, cousue d’adjectifs et aisément ponctuée.
Alexandrine est épuisée, cela fait presque vingt ans qu’elle se consacre exclusivement à son mari : « Elle flanche. L’admettre la tue, mais elle ne sait plus où puiser l’énergie qui l’a maintenue debout tout ce temps. Elle voudrait pouvoir s’allonger. Elle rêve que sa vie se dissolve et disparaisse. Elle est si lasse. Ce matin, son corps a refusé d’accepter. Elle en ignore la raison, mais en connaît la cause. Tapie dans l’ombre du salon, elle sait la silhouette affaissée de Blaise, tête penchée en avant dans son fauteuil d’infirme. »
La violence sur les corps des bêtes
Pour la première fois, Alexandrine accepte une invitation, un week-end, une chasse à courre, chez une amie d’enfance. Pour la première fois, elle abandonne son mari. La petite bonne s’occupera de Monsieur et dormira sur place.
Le week-end s’annonce bien pour Alexandrine, éloignée du corps mutilé de Blaise. Mais la violence sur les corps des bêtes, le jeu des corps dans la partition d’un certain libertinage, son propre corps qu’elle ne sait plus même identifier, tous les corps cachés derrière des « valeurs », ce jeu des corps qui, dans les années 1930, fabrique l’oubli de la guerre passée et repousse celle à venir attisent sa culpabilité.
Bousillée par un avortement, fatiguée par la charge
Du corps, il est question aussi dans le duo de Blaise et de la petite bonne. Lui, « coincé dans ce corps abominable » et elle, abîmée par les coups de « son homme », bousillée par un avortement, fatiguée par la charge, partagent leurs meurtrissures par un contact, une attention, un élan de considération, de grâce, d’humanité : « Il a ri, fumé, mangé avec appétit, il est propre et coiffé. Il s’est occupé de ce corps qui lui faisait horreur et en a tiré – il a d’ailleurs du mal à le reconnaître – il en a tiré un certain plaisir. Non, il reprend : elle s’est occupée de lui, elle l’a ranimé, entretenu, pris en compte. »
De sa vie d’avant, reste à Blaise la musique. Elle s’évade des corps, déborde les mots, sublime les vies. Il peut encore en donner… La petite bonne a-t-elle le droit de cultiver son âme ?
Un troisième texte, lui aussi en vers libre mais « fer à droite » parsème ce roman. Dès la première page, il s’annonce :
Les cent pas
j’aimerais pouvoir les faire
réellement
Ici c’est cinq pas dans la longueur
à peine trois dans la largeur
et vraiment
des petits pas
Des traversées
Il en faut quelques-unes
pour arriver à cent
C’est long
mais jamais assez.
Une partition littéraire intense et profonde
Qui, d’elle ou de lui, de sa prison, porte cette voix ? Ce n’est qu’aux dernières pages de ce livre que le lecteur le saura, et que la dramaturgie se dévoilera.
Oui, ce livre sans dialogue, ce livre de taiseux qui se livrent en vers et en prose, est une partition littéraire intense et profonde, un requiem, une prière pour les âmes, même lorsque l’on n’y croit pas. Obsédant !
- Bérénice Pichat, La Petite Bonne, Les avrils, 2024, 272 pages, 21,10 euros.