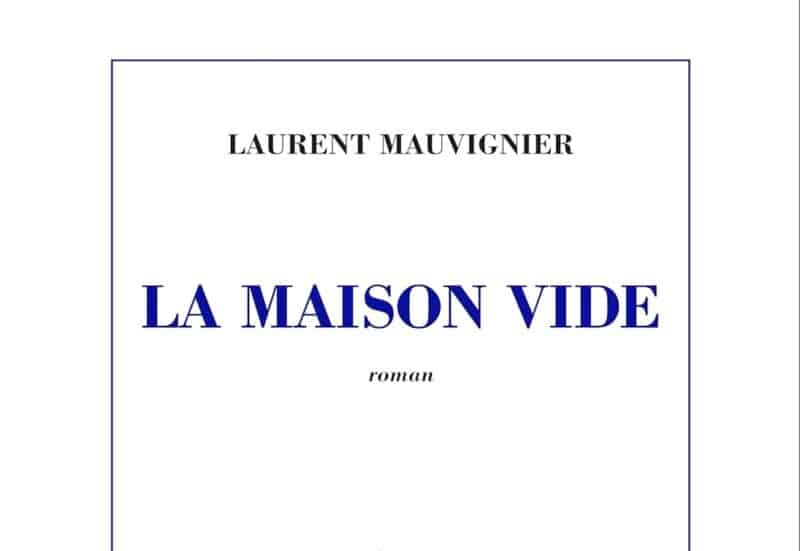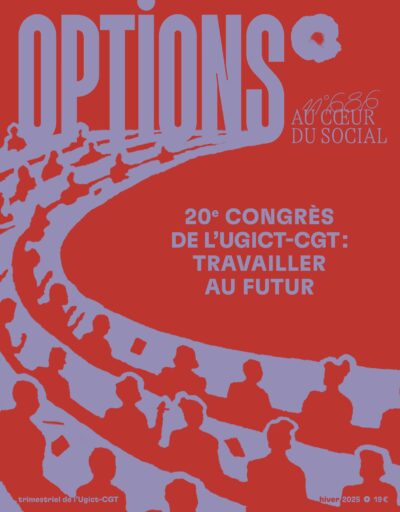Pour qui a connu une maison pleine de vie, voire de vies, observer cette maison vide la désigne immédiatement comme un « Lieu de mémoire » : « La maison vide » de Laurent Mauvignier est bien un lieu de mémoire, installé à La bassée, bourg inventé, mais qui évoque la localité où l’auteur a déroulé son enfance. Une terre rurale et plate, de ces coins d’où l’on voit la route arriver, et repartir dans l’autre sens, une terre où l’Histoire a dévalé sans être réfrénée par des monts et des vaux.
Comme souvent, cette maison vide de vie abrite encore quelques rares objets : un grand piano échoué au salon, du papier peint agrippé aux murs, l’intégrale des Rougon-Macquart d’Émile Zola, quelques photos dont un visage a été systématiquement soit découpé soit barbouillé, peut être une Légion d’honneur… Mais surtout, subsistent quelques souvenirs au narrateur, dont le premier constitue assurément l’amorce de ce roman et le déclencheur de cette narration : le père s’est suicidé. Serait-il possible que cet acte soit le produit direct ou indirect d’une généalogie, sorte de tunnel souterrain ouvrageant le présent ?
Alors, armé de sa mémoire – un peu de ce qu’il a vécu, mais surtout de ce qu’on lui a raconté –, il tente de retracer l’histoire de sa famille. Et lorsque la mémoire vacille, lorsque les murs restent mutiques, quand les fenêtres sont murées dans leurs silences, et les portes ayant effacé toute trace de passage, alors l’auteur fait « parler » les silences, les trous, le vide : « C’est parce que je ne sais rien ou presque rien de mon histoire familiale que j’ai besoin d’en écrire une sur mesure, à partir de faits vérifiés, de gens ayant déjà existés, mais dont les histoires sont tellement lacunaires et impossibles à reconstituer qu’il faut leur créer un monde dans lequel, même fictifs, ils auront une importance », précise Laurent Mauvignier.
Quatre générations se succèdent dans la maison, entre 1860 et 1960. D’abord, le patriarche Firmin Proust et son épouse « préposée aux confitures et aux chaussettes à repriser ». Deux garçons naissent, les deux quittant la maison, l’un pour entrer dans les ordres, l’autre pour une grande ville afin de faire commerce de colifichets. Reste, pour reprendre les rênes de l’entreprise familiale, la fille, Marie-Ernestine, qui, malheureusement s’intéresse plus au piano et à son professeur qu’aux problèmes de succession. Firmin offre à sa fille un piano, (Le piano) et un mariage avec Jules Chichery, « qui a l’air d’un péquenaud », menuisier de son état. Le mariage, célébré le 17 juin 1905, marque la destruction des rêves de la jeune femme. En 1913, naît Marguerite.
À la mort de Firmin, sa femme, anciennement préposée aux confitures et aux chaussettes à repriser, Jeanne-Marie (née Florabelle) gère avec autorité la propriété. La guerre gronde et Jules est mobilisé. Il n’aura qu’une seule permission de six jours et meurt le 18 mai 1916 dans le bois d’Avocourt : « Il a tenu l’ennemi en respect pendant quarante-huit heures, avec cinquante autres héros, permettant aux troupes françaises de sauver une position stratégique » est-il inscritsur le monument aux morts communal, héroïsme récompensé par la Légion d’honneur et la Croix de Guerre.
Obnubilée par son piano, Marie-Ernestine ne s’occupe pas de sa fille. Marguerite est placée en apprentissage, elle apprend le sexe réservé à sa condition, revient enceinte, trouve un mari, André, qui accepte de reconnaitre l’enfant.
Marie-Ernestine a elle aussi trouvé un époux, un notaire du coin, veuf et père d’un garçon, Rubens. Mais l’histoire se déroule et la guerre revient : André et Rubens sont mobilisés, capturés par les Allemands. Rubens est rapidement libéré. André ne revient pas, Marguerite s’inquiète. Elle veut en savoir plus, et visite régulièrement l’occupant, qu’émendant des informations : à la libération, elle sera tondue. Marguerite est la grand-mère de l’auteur, la mère du suicidé…
Évidemment, ce roman fait penser aux œuvres de la fin du XIXe siècle : Marie-Ernestine et Marguerite sont des personnages à la hauteur de madame Bovary, elles ne font pas toute l’histoire, mais dessinent le destin des « Mauvignier ». Quant à Zola, présent physiquement avec l’intégrale des Rougon-Macquart, il saluerait les êtres qui naviguent au gré des vents de l’Histoire, avec la part de subi et la part volontaire, les personnages qui dévoilent le corps social auquel ils appartiennent tout autant que leur corps personnel, individuel. Pas sûr que les aliénations sociales aient beaucoup changé
La littérature sert à combler des absences, des trous, des effacements, des oublis, semble dire l’auteur. Toutes ces éclipses, ces disparitions, ces amnésies qui manquent à l’appréhension d’un factuel historique sont comblées par l’imaginaire de l’écrivain, non pas en force, en démonstration, mais avec précision, au service de l’intimité, de la proximité des êtres, et pour réparer les transmissions brisées. Pour cela, jamais Laurent Mauvignier ne déroule qu’un unique fil, chaque page amène diverses propositions que le lecteur choisit de suivre ou pas, d’en goûter le multiple des possibles : pour se ressaisir du réel qui se dérobe, ce roman hors norme, au service de la complexité des hommes et des femmes permet de remonter les fleuves de violence, d’aller voir à la source, d’explorer notre temps, les yeux ouverts. Échapper à la banalité en affirmant que c’est le livre de la rentrée serait illusoire, mais déclarer que ce roman est une œuvre pleinement accomplie, c’est-à-dire un chef-d’œuvre est une évidence !
Dans une autre « maison vide »
En 1989 est parue « la maison vide », de Claude Gutman. La famille de David est juive et athée. Le père a échappé à un pogrom, en Pologne, et il a l’intime assurance que la France sera protectrice. Pour autant – parce que l’on ne sait jamais – en 1942, il envoie son fils dormir chez des amis, juste en face. Et c’est du lieu de son hébergement temporaire que le jeune David verra ses parents être emmenés entre deux policiers français : la rafle du Vél’ d’hiv’ percute violemment l’histoire. Roman à destination des adolescents, mais aussi des plus vieux, « la maison vide » de Claude Gutman est bien un « Lieu de mémoire » : mémoire d’une vie d’avant, sécurisée et confiante, face à un avenir terrifiant et mouvant. Ce roman, si simple et émouvant, à la générosité au bord de chaque ligne, tout en retenue, raconte comment la disparition d’un « Lieu de mémoire » nous entraine au royaume du flottant, de l’insondable, du mouvant, pour le meilleur comme pour le pire — si souvent pour le pire — .
Une ode d’un fils à sa mère
Le dernier roman d’Emmanuel Carrère, « Kolkhoze », est une ode à sa mère, première femme à devenir secrétaire perpétuelle de l’Académie française.
Créée en 1635 par le cardinal de Richelieu, l’Académie française est une institution dont la vocation est de définir l’usage correct de la langue française, de publier le dictionnaire de référence et doit « travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences » (article 24 de ses statuts). En être membre, et mieux encore en devenir la secrétaire perpétuelle donc la garante de la langue française, Hélène Carrère d’Encausse, née apatride, devenue française à l’âge de 21 ans, comble ainsi son irrésistible ascension sociale au service d’une soif dévorante d’intégration. Son fils, Emmanuel Carrère, commence son dernier livre par l’hommage de la Nation, le 3 octobre 2023, dans la cour des Invalides à sa mère, décédée 53 jours auparavant. Il narre cette incroyable histoire familiale autour d’Hélène Zourabichvili, d’origine russe et issue d’une lignée d’aristocrates ayant fui la révolution bolchévique, cousine de Salomé Zourabichvili, ex-présidente de la Géorgie.
Louis-Édouard Carrère d’Encausse, mari effacé d’Hélène, méprisé au point d’être relégué dans une petite pièce, au bout du couloir, décèdera 147 jours après son épouse, à mon avis, de chagrin, fut fasciné par l’histoire de sa femme, par sa « distinction aristocratique » : il consacra une partie importante de sa vie à des recherches généalogiques qui sont indéniablement les fondations historiques du livre. Raconter Hélène Carrère d’Encausse, c’est étudier aussi la vie de Louis-Édouard : « La chose la plus inattendue pour moi, c’est la façon dont a monté la figure de mon père, comme si, petit à petit, il était sorti de l’ombre dans ce livre. Et ça, ça me fait plaisir parce que je ne l’avais pas vu venir ».
Reste que cette mère soigna une relation d’amitié avec l’écrivain fasciste et négationniste Maurice Bardèche, (pour mieux le rejeter par la suite), qu’elle fut « la » spécialiste de la politique russe, intime du Kremlin, côtoyant ses chefs, s’indignant de « la diabolisation de la Russie », irritée par « la sanctification de l’Ukraine », obstinément indulgente envers Poutine.
Reste que ce livre ausculte avec précision les relations épineuses, difficiles et tendues entre le fils et sa mère.
Mais restent surtout les souvenirs d’enfance : lorsque le père absent (en voyage d’affaire), Hélène invitait ses enfants à se regrouper dans sa chambre, autour du lit maternel, d’amener des matelas, de passer ainsi la nuit, au chaud de l’amour maternel, c’est cela qu’elle appelait faire Kolkhoze. Et bien plus que l’Académie française, ce Kolkhoze est le « Lieu de Mémoire » du livre d’Emanuel Carrère, autour du lit où s’ancre l’amour maternel.
*« Les lieux de mémoire, ce sont d’abord des restes. La forme extrême où subsiste une conscience commémorative dans une histoire qui l’appelle, parce qu’elle l’ignore. » Pierre Nora, historien (1931-2025).
- La maison vide, Laurent Mauvignier, Minuit, 25 euros
- La maison vide, Claude Gutman, Folio Junior, 7 euros
- Kolkhoze, Emmanuel Carrère, Pol, 24 euros