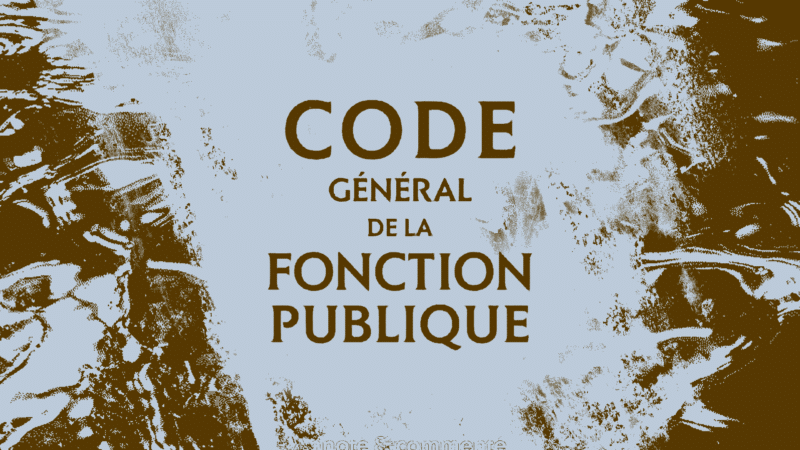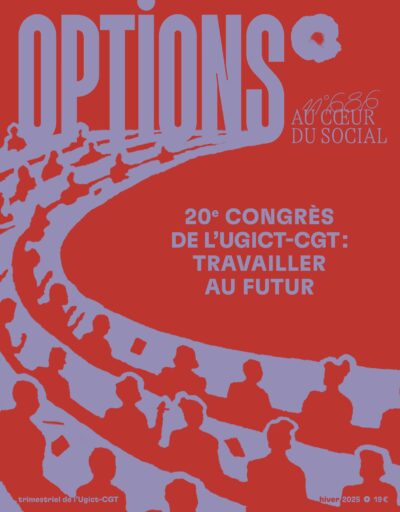En application des dispositions de l’article L. 714-4 du Code général de la fonction publique (CGFP), le régime indemnitaire des agentes et agents est fixé localement par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou par le conseil d’administration de l’établissement public, dans la limite des régimes dont bénéficient les fonctionnaires de l’État.
Ainsi, il revient à chaque assemblée ou conseil de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités attribuées aux agents territoriaux, sans que le régime institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État d’un corps et d’un grade équivalents ; et sans que l’organe délibérant soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’État (1). Aussi le régime indemnitaire de référence fait-il office de limite maximale : pour chacun des éléments qui le composent, l’organe délibérant peut décider de l’appliquer à l’identique, de l’appliquer de façon restreinte ou de ne pas l’appliquer. L’organe délibérant peut ainsi retenir des montants de référence inférieurs et des conditions de versement plus restrictives que ceux applicables aux fonctionnaires de l’État. Mais il ne peut en aucun cas dépasser les limites prévues au bénéfice des agents de l’État, c’est ce que le juge administratif appelle « le principe de parité ».
Le respect de ce principe d’équivalence et la marge de manœuvre laissée aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux entraînent des répercussions sur les conditions d’attribution individuelle du régime indemnitaire. Ainsi, le régime indemnitaire alloué à un agent territorial ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficie un fonctionnaire de l’État exerçant des fonctions équivalentes (2). Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 établit des équivalences entre grades des cadres d’emplois territoriaux et grades des corps de l’État, dans les filières administrative, technique, médico-sociale, culturelle, sportive et d’animation. Les corps équivalents constituent donc une référence et une limite.
À noter qu’une réponse ministérielle est venue préciser que toute modification des textes applicables aux fonctionnaires de l’État cités par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, précité est applicable par délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public local, sans qu’une modification de ce décret soit nécessaire (3)
En outre, le Conseil d’État vient d’indiquer que lorsque l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale a défini le régime indemnitaire bénéficiant à ses fonctionnaires par référence à celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État d’un grade et d’un corps équivalents, la modification apportée au régime indemnitaire de ces fonctionnaires de l’État n’a pas pour effet, par elle-même, de modifier ou de rendre inapplicables les règles instituées par cette assemblée délibérante. En revanche, il appartient à cette dernière de tirer, le cas échéant, les conséquences d’une telle modification en abrogeant ou en modifiant expressément les règles régissant les indemnités versées à ses propres fonctionnaires qui ne seraient plus conformes aux dispositions législatives applicables en matière de régime indemnitaire (4).
En l’espèce, par délibérations des 11 novembre 2002, 22 février 2010 et 5 avril 2014, le conseil municipal de Lespinassière (Aude) avait instauré pour les agents de la commune un régime indemnitaire faisant référence à celui créé, pour les agents de l’État, par le décret du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) et l’avait attribué à Mme A., rédactrice territoriale. Puis, après que L’IEMP ait été abrogée (à compter du 1e janvier 2017 pour les agents de l’État, par un décret du 5 mai 2017 portant création d’une indemnité temporaire de sujétion des services d’accueil), la commune n’avait adopté aucune délibération abrogeant ou modifiant expressément le bénéfice de l’indemnité qu’elle avait elle-même instaurée pour ses propres agents, ni institué un nouveau régime indemnitaire.
Dès lors, estime le Conseil d’État, en jugeant que la commune de Lespinassière avait pu, du seul fait de la modification apportée au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’État qu’elle avait pris pour référence, légalement cesser de procéder, à compter du 1er janvier 2017, au versement à Mme A. de l’indemnité qu’elle avait instituée par les délibérations mentionnées ci-dessus, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Aussi, l’agente est-elle fondée à demander l’annulation de l’arrêt de ladite cour qu’elle attaque dans la mesure où, réformant le jugement de première instance, il a ramené à un montant inférieur la somme que la commune de Lespinassière était condamnée à lui verser.
Les avantages pécuniaires qui échappent au principe de parité
Ils sont principalement de deux ordres.
En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 714-11 du CGFP, sont maintenus les « avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération ». Cette notion renvoie aux gratifications à appellations diverses (« 13e mois » ; « prime de fin d’année », « prime de vie chère »…) instituées avant le 28 janvier 1984 (date d’entrée en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale), qui étaient souvent versées indirectement, par l’intermédiaire de structures associatives subventionnées, telles qu’un comité des œuvres sociales ou une amicale du personnel. Les sommes correspondantes étaient donc considérées, dans le budget de la collectivité ou de l’établissement, comme des subventions, alors qu’elles correspondaient à des dépenses de rémunération du personnel.
Ces avantages collectivement acquis, ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont institué avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l’ensemble de leurs agentes et agents, lorsqu’ils sont pris en compte dans le budget, sans aucune exigence de parité avec les corps de l’État. Ils viennent donc s’ajouter au régime indemnitaire versé en application de l’article L. 714-4 du CGFP.
Attention : le maintien des avantages collectivement acquis n’est pas irrévocable. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent l’abroger (5).
Par ailleurs, l’article L. 731-1 du CGFP dispose que l’action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, et à les aider à faire face à des situations difficiles. Dans ce cadre, des prestations d’action sociale individuelles ou collectives peuvent être octroyées ; celles-ci présentent les caractéristiques suivantes :
- le bénéficiaire doit participer, hors dispositions spécifiques à certaines prestations, à la dépense engagée. Cette participation doit tenir compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale (6).
- elles ne constituent pas un élément de la rémunération, et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi et de la manière de servir (7).
La jurisprudence administrative caractérise l’action sociale en fonction de la prise en considération de la situation sociale, économique et familiale de chaque agent. Ainsi, une aide prévue indistinctement en faveur de l’ensemble des agentes et agents peut être considérée comme un complément de rémunération, a fortiori si son montant est élevé (8). Dès lors que leur définition législative les distingue de la rémunération, les prestations d’action sociale ne sont pas assujetties au principe de « parité » avec la fonction publique de l’État.
En outre, à côté du régime indemnitaire fixé en référence à celui de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux peuvent instituer une prime d’intéressement tenant compte de la performance collective des services (9).
Dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, il revient à l’organe délibérant de déterminer le type d’actions à mener et le montant des dépenses à engager pour les prestations d’action sociale, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre (10). Les dépenses correspondantes font partie des dépenses obligatoires qui s’imposent aux communes, aux départements et aux régions (11).
Les cadres qui échappent au principe de parité
Les fonctionnaires relevant de certains cadres d’emplois bénéficient d’un régime dérogatoire, qui n’est pas soumis au principe de parité.
Peuvent ainsi bénéficier d’éléments indemnitaires fondés sur des textes spécifiques, hors de toute équivalence avec des corps de fonctionnaires de l’État (12) :
- les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres ;
- les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la filière des sapeurs-pompiers professionnels ;
- les fonctionnaires relevant de l’un des cadres d’emplois de la filière médico-sociale listés par décret (en attente de publication).
Edoardo Marquès
- Conseil d’État, 4 juillet 2024, M.B. A., requête n° 462452 ;
- Article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l’application de l’article 714-4 du Code général de la fonction publique ;
- Réponse à la question écrite d’un sénateur, n° 5102, publiée au Journal officiel du Sénat, du 30 mai 2013, P. 1663 ;
- Conseil d’État, 26 septembre 2025, Mme A., requête n° 488350 ;
- Conseil d’État, 21 mars 2008, Commune de Bergheim, requête n° 287771 ;
- Article L. 731-1 du CGFP ;
- Article L. 731-3 du CGFP ;
- CAA Bordeaux, 28 mai 2001, préfet de la Charente-Maritime, requête n° 97BX00435 ;
- Article L. 714-7 du CGFP ;
- Article L. 731-4 du CGFP ;
- Respectivement : articles L. 2321-2, L. 3321-1 et L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales ;
- Articles L. 714-10, L. 415-5 et L. 714-13 du CGFP.